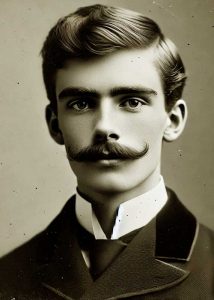Dietrich et moi restâmes seuls dans la pièce, tandis que le silence se figeait comme un linceul. L’air semblait plus dense, presque tangible, chargé d’une tension indescriptible. Je pris le violon entre mes mains, le bois froid et lisse semblant vibrer faiblement sous mes doigts, comme animé d’une vie propre. Solennellement, je le lui remis, un geste qui me parut comme sceller un pacte inéluctable avec des forces que je ne pouvais comprendre.
Dietrich s’en saisit avec une délicatesse quasi révérencieuse. Ses mains, agiles et précises, effleurèrent les cordes, ajustant leur tension avec une concentration féroce. Il manipulait l’instrument comme un artisan parfait devant une œuvre sacrée, l’affinant avec une patience méticuleuse. Je l’observais, à la fois fasciné et pétrifié, sentant une ombre d’éternité s’étendre autour de nous.
— Asseyez-vous, dit-il, sans lever les yeux du violon.

Sa voix était calme, mais elle portait un poids qui me cloua sur place. Je m’assis docilement, mon souffle court, les mains tremblantes. Un frisson glacé parcourut mon échine, une peur ancienne s’insinuant au plus profond de moi.
Dietrich leva enfin l’archet, et les premières notes jaillirent. Dissonantes, elles me frappèrent comme des éclats de verre, leurs vibrations erratiques semblant heurter les lois mêmes de l’harmonie. Ces sons, étranges et discordants, montaient dans l’air, une ascension lente et inexorable qui semblait ébranler les murs eux-mêmes.
Au loin, dans la nuit, un cri fendit les ténèbres. Céline. Son désespoir résonnait, déchirant, un écho lointain de tout ce que nous avions sacrifié. Son hurlement me traversa comme une lame, mais je savais qu’il était déjà trop tard. Il n’y avait plus de retour possible.
Dietrich enchaîna. Les notes devinrent plus complexes, une mélodie d’une étrangeté inconcevable s’élevant au-dessus de l’abîme sonore. Les accords semblaient se heurter et s’entrelacer en un chaos presque insupportable. Pourtant, dans cette cacophonie dérangeante, il y avait une terrible cohérence, une structure inhumaine qui défiait toute compréhension.
La musique s’insinua en moi, s’accrochant à mon esprit, envoûtante et intrusive. C’était comme entendre les échos d’un monde oublié, des murmures anciens qui n’auraient jamais dû atteindre des oreilles humaines. Les sons eux-mêmes semblaient vibrer en synchronie avec quelque chose d’invisible mais omniprésent, quelque chose qui dépassait le simple cadre de cette pièce exiguë.

Puis, cela arriva.
L’air changea. Non, ce n’était pas l’air qui changeait, mais ma perception de celui-ci. L’atmosphère, jusqu’alors dense et lourde, se mit à pulser au rythme de la musique. Les murs semblèrent vaciller, onduler comme s’ils n’étaient qu’un rideau masquant une vérité plus vaste. Une vérité terrible et infinie.
Je sentis quelque chose en moi se briser, ou peut-être était-ce une ouverture. Une part de moi-même se détacha, s’éleva doucement comme une feuille emportée par le vent. Je quittais mon corps.
Flottant au-dessus de moi-même, je regardais, horrifié et fasciné, cet homme assis face à Dietrich. Était-ce vraiment moi ? Ma conscience, désormais libre, s’éleva encore, traversant les limites mêmes de la pièce.
Je volais. Au-dessus de Paris, je voyais une ville baignée d’une lumière irréelle. Les rues étaient illuminées, mais pas par le feu ou les lanternes. C’était une lumière étrange, vibrante, pulsante, semblable à la musique. Le sol tremblait, et des fissures gigantesques s’ouvraient, laissant surgir des montagnes titanesques où il n’y avait auparavant que des plaines.
Au loin, une comète décrivait une spirale dans le ciel noir, son éclat spectral illuminant des formes qui défiaient toute description. Mon esprit vacillait, incapable de saisir pleinement ce qu’il percevait.
Et au cœur de ce chaos, je sentis comme une force, une présence indicible, immense et insondable, qui m’observait.



Le ciel au-dessus de Paris change. Lentement. Mais c’est cette lenteur même qui me terrifie. La spirale, d’abord si petite, à peine perceptible, s’étire maintenant dans un mouvement qui semble éternel. Elle palpite, chaque éclat de sa lumière étrangère résonnant en moi comme une lame effleurant mon âme. Elle ne cesse de croître, d’étendre ses ramifications infernales dans toutes les directions, embrassant la ville entière comme une bête cherchant à engloutir sa proie.
Chaque pulsation est un rappel implacable de l’inévitable. C’est une mélodie sans fin, une harmonie étrangère, une trahison de la réalité elle-même. Les contours de Paris s’effacent peu à peu dans mon esprit. Je suis ici, et pourtant ailleurs.
Et puis, il y a Dietrich. Ce nain, cet être grotesque, semble transcender l’humain, son violon vibrant d’une rage surnaturelle. Sa musique n’a plus rien d’humain. Elle est une cacophonie infernale, un hurlement jaillissant des abîmes, jouant à une vitesse inouïe. Ses doigts sont un flou, une illusion, comme s’ils se multipliaient, jouant des centaines de notes simultanément. Cette musique, si l’on peut encore appeler cela musique, est une entité vivante. Elle me transperce, m’enveloppe, m’engloutit.

Un tourbillon naît alors au centre de la pièce. D’abord subtil, il s’amplifie, grandit, son centre noir aspirant toute lumière. Les couleurs autour de lui dansent, éclatent en une symphonie de nuances impossibles, mais toujours froides, toujours menaçantes. Ce n’est pas un simple phénomène ; c’est une fracture dans notre réalité.
Je sens la douleur. Pas seulement dans ma tête, mais dans tout mon corps. Mes oreilles bourdonnent si violemment qu’elles semblent prêtes à éclater. Chaque fibre de mon être hurle, mais je tiens. Une partie de moi puise dans des ressources insoupçonnées, une résistance désespérée face à cette puissance écrasante. Mais je sens aussi que cela ne suffira pas. Cette force s’infiltre en moi. Elle est le froid, ce froid glacial qui semble jaillir directement du cœur de la spirale, m’envahissant, gelant jusqu’à mes pensées.
Et alors, le sol disparaît.
Ou plutôt, il ne disparaît pas – il se transforme. Sous mes pieds s’ouvre un abîme sans fin. Les murs de la pièce s’effacent, remplacés par un vide constellé d’étoiles. Je suis dans un autre monde, une autre dimension. Le toit lui-même s’épanouit lentement, comme une fleur monstrueuse révélant un cosmos infini. Les étoiles au-dessus de moi scintillent d’une manière qui n’a rien de naturel. Elles vibrent, se déplacent, dansent dans un ballet non-euclidien qui défie toute logique humaine.
Le temps perd son sens. Je ne sais plus si cela dure une seconde ou une éternité. Chaque étoile, chaque fragment de ce néant semble murmurer, me parler, m’attirer dans une spirale hypnotique. C’est un vertige constant, une ascension et une chute simultanées, un paradoxe qui défie ma raison.

La spirale dans le ciel continue de tourner. Plus rapide. Plus hypnotique. Elle m’appelle, et une part de moi veut répondre. Mais je résiste encore, bien que ma volonté soit une ombre vacillante.
Et cette musique… elle n’est plus extérieure. Elle est en moi, dans mes veines, dans chaque battement de mon cœur. Elle m’épuise et me nourrit tout à la fois. Je ne suis plus un homme. Je suis devenu une note dans cette symphonie cauchemardesque.
Un cri silencieux jaillit alors en moi. Je suis seul. Non, je ne le suis pas. Quelque chose, là, dans l’obscurité, m’observe. Une présence. Immense. Indifférente. Je ne peux la voir, mais je la sens, son regard pesant sur moi comme un millier de soleils noirs.
Et soudain, une pensée terrifiante s’impose : l’homme n’a pas sa place ici.
Tandis que Dietrich frappait, raclait, extirpait l’essence du violon dans une frénésie incontrôlée, une nouvelle horreur s’abattit sur moi. Ce ne furent pas seulement les notes qui m’assaillirent, mais une myriade de battements d’ailes, étouffants et effrayants. Invisibles à l’œil, ces battements semblaient provenir de choses sans forme, de créatures faites de vide et de murmures. Elles tourbillonnaient autour de moi, me lacéraient avec une insistance insupportable, comme si elles cherchaient à s’infiltrer dans ma chair, à s’emparer de ce qu’il restait de mon esprit.

Ces battements devinrent si puissants qu’ils surpassèrent même la musique, se confondant avec elle dans une cacophonie apocalyptique. Et sous les assauts toujours plus rageurs de Dietrich, le violon céda. Ses cordes se désagrégèrent les unes après les autres, puis la structure même de l’instrument, comme si son essence tangible s’effaçait pour devenir immatérielle, un écho s’élevant dans l’abîme infini du cosmos. Mais cette désintégration ne fut pas une libération : elle marqua le début de quelque chose de bien pire.
Les fragments du violon, flottant un instant dans l’air éthéré, commencèrent à converger vers moi. Ils me pénétrèrent, un à un, en s’imprégnant de ma chair et de mon esprit. Je pouvais sentir le bois craquer à l’intérieur de mes veines, sentir la résonance des cordes dans mes os, entendre la complainte maudite de cet instrument maudit au plus profond de mes pensées. Ce n’était plus seulement la musique qui m’habitait, mais le violon lui-même. Il devenait une extension de mon être, un fragment de ma propre âme corrompue.
Et alors, comme un éclat de verre brisant un miroir, la vérité s’imposa à moi dans une révélation insoutenable. La musique, si terrible, si abominable, était un enseignement. Une clé ouvrant les portes de la réalité véritable. Le voile rassurant de notre monde s’était levé, et ce que je vis derrière était une abomination sans nom. Notre existence même n’est qu’une erreur, une anomalie dans le tissu du cosmos. Le véritable maître de l’univers n’est pas un dieu bienveillant ou un ordre cosmique harmonieux, mais un chaos primitif et omniprésent. C’est nous, les humains, qui sommes l’intrusion, les parasites d’un monde qui ne nous appartient pas.

Plongé dans cet abîme de compréhension, je fus submergé par des visions insupportables. Elles me hurlèrent la vérité dans un langage qui n’appartient pas à notre monde. Paris était en ruines, consumé par des flammes noires et dévasté par une force inimaginable. Ses habitants, zombifiés, hypnotisés, avançaient comme une horde sans âme vers une lumière vacillante. Et cette lumière… elle n’était pas ce qu’elle semblait être. Elle se métamorphosa en un être qui échappait à toute tentative de description. Un monstre titanesque, fait d’étoiles et d’obscurité, descendait lentement des cieux.
Je sus alors, sans l’ombre d’un doute, quel était cet être ancien, cette horreur infinie. Azathoth, le chaos primordial, la démesure cosmique personnifiée, me regardait. Mon esprit vacilla à sa simple contemplation, comme si ma conscience était une feuille face à une tempête dévastatrice.

Alors que les derniers éclats d’un violon maudit s’évanouissaient, remplacés par un vide assourdissant, une autre horreur s’éleva dans cet espace brisé. Des rires. Oh, pas des rires humains, pas seulement. Ils étaient nombreux, se déversant comme une rivière d’échos, venant de partout, de nulle part, emplissant l’air, ma chair, mon âme. Et parmi eux, je reconnus le mien. Oui, mon propre rire, déformé, grotesque, s’élevait au milieu de cette cacophonie abjecte. Mais pire encore… je reconnus aussi les rires de mes compagnons. Renault, Babin, Hugel, Dupois, Pressi tous pris au piège, incapables d’échapper à cette dérision cosmique.
Et au-dessus de tout cela, je le sentais. Azathoth. L’aberration. Le chaos. L’inexorable. Ses mouvements, imperceptibles mais écrasants, se rapprochaient de nous comme un raz-de-marée silencieux. Chaque pulsation de son existence effritait ce qu’il restait de mon esprit. Je n’étais plus qu’un spectateur impuissant, voyant mon être se fragmenter, mes pensées se briser comme des vagues sur un récif maudit.

Je ne pouvais pas lutter. Je ne pouvais pas fuir. Il n’y avait aucune échappatoire à cette vérité fondamentale. La seule issue était de cesser d’être, de me réfugier dans la folie, de me plonger dans cet abîme salvateur où aucune lumière de compréhension ne pouvait percer. Car comprendre était la malédiction ultime. Et pourtant, même dans cette chute, je savais qu’il n’y avait pas de retour possible. Azathoth avait gagné.
Lorsque le néant m’engloutit, ce fut un soulagement amer. Tout s’arrêta : les rires, la musique, même les pensées. Il ne restait rien, pas même un rêve ou un soupir, seulement ce gouffre infini, sans couleur, sans chaleur, sans mémoire. Et pourtant, lorsque j’émergeai, ce n’était pas le silence qui m’accueillit, mais cette maudite musique.
Elle n’avait pas disparu. Elle était là, enfouie en moi, comme une brûlure qui ne s’efface jamais. Je l’entends encore. Parfois forte, parfois faible, mais toujours présente, comme une tumeur enfouie dans l’âme. Et avec elle, la folie, une compagne fidèle, une amante cruelle qui ne me quitte jamais.

J’ouvre les yeux. Lentement. Doucement. L’éclat terne de la pièce m’assaille comme une vérité que je ne veux pas affronter. Tout semble… normal. Trop normal. L’espace autour de moi, qui quelques instants auparavant — ou était-ce une éternité ? — hurlait une terreur insensée, est redevenu étrangement calme. Mais ce calme n’est qu’une façade.
Dans un coin sombre de la pièce, mon regard se pose sur des griffures dans le bois, des entailles profondes, désespérées. Il m’apparaît que d’autres ont été ici avant nous, des âmes damnées qui ont tenté de s’échapper. Non pas de cette pièce, non — car où auraient-elles pu fuir ? — mais vers lui. Vers Azathoth. Un frisson glacé serpente le long de mon échine, malgré mon esprit brisé, car je sais que ces marques sont la trace d’une lutte vaine contre une force qui dépasse l’entendement.
Mon regard se détourne, presque malgré moi, et tombe sur une silhouette immobile. Le corps du nain. Inanimé, décharné. Sa forme réduite à une coquille grotesque. Les ombres jouent sur ses traits figés, creusant davantage les abîmes d’horreur dans lesquels je sens déjà mon esprit glisser.
Je tente de bouger, mais mon corps me trahit. Mes membres sont lourds, étrangers. Le simple acte de respirer semble une montagne à gravir. Petit à petit, je parviens à m’arracher à cette torpeur. Chaque geste est un combat, chaque mouvement un rappel de mon impuissance. Je sens que ce corps, ce qui fut autrefois le mien, n’est plus qu’un vaisseau vidé, un simulacre d’existence.
Je me redresse, titubant, et mon attention se fixe sur Dietrich. Dietrich… Il est là, étendu, son violon brisé dans une étreinte macabre. Ses doigts, noirs et carbonisés, semblent fusionnés au bois fracturé de l’instrument, comme si cet objet maudit avait exigé de lui un ultime tribut. Ses bras portent les stigmates d’un brasier inconnu, et son visage… ah, ce visage ! Une expression d’effroi gravée pour l’éternité, ses yeux ouverts sur des abîmes que je ne souhaite à personne de contempler.
Je ne ressens rien. Pas de tristesse. Pas de colère. Pas même de peur. Mon esprit est détaché, flottant quelque part entre cette réalité et le chaos des sphères. Je contemple la scène avec un regard clinique, froid, étranger. Peut-être est-ce ma folie qui me protège de l’horreur. Peut-être est-ce simplement que je ne suis plus humain.

Mais je sais. Je sais ce qu’il a vu. Ses yeux ne mentaient pas. La vision d’Azathoth, dans toute sa splendeur et sa terreur, l’a consumé. Il n’a pas survécu. Aucun de nous n’a survécu, pas vraiment.
Je me tiens là, immobile, regardant ce qui reste de mon compagnon. Mon esprit est ailleurs, toujours prisonnier de ce cosmos où rien n’a de sens, où les lois de la réalité s’effacent face à l’aberration ultime. Et pourtant, une pensée me hante : je dois y retourner. Je n’ai pas le choix.
Car une vie éternelle de supplice m’attend. Écouter cette musique maudite, qui résonne encore dans mon esprit, pour toujours. Comme les âmes qui peuplent le trône de l’Abîme, je suis maintenant une note de plus dans la symphonie insupportable de la désolation. Il n’y a pas de rédemption.
Azathoth m’attend, et je vais répondre à son appel.
Je me rends compte, soudainement, que ma plume trace ces mots sur le papier, tandis que je suis assis à table parmi mes camarades.
Je n’écris plus vraiment pour les hommes. Chaque mot que je trace est un murmure à moi-même, un écho dans l’abîme où je suis tombé, une tentative désespérée de comprendre, ou peut-être simplement de ne pas me perdre davantage. Car qu’est-ce qu’un esprit peut faire face à l’incommensurable, face à une terreur si pure, si totale, qu’elle dépasse le langage, les images, le temps même ?
Ces mots, dérisoires et maladroits, ne suffisent en rien à capturer l’indicible, à décrire l’abîme insondable dans lequel mon esprit s’est précipité. Pourtant, j’écris, car il le faut. La vérité que je porte doit être livrée, tout comme mon destin inexorable doit être accompli. Ce n’est pas un récit. C’est une confession. Une malédiction gravée sur du papier. Je suis un homme mort qui marche, condamné à porter en moi cette symphonie de l’abîme, à contempler à jamais les vérités insoutenables qu’elle m’a révélées.
Que celui qui lit ces lignes sache : la folie n’est pas un refuge. C’est une prison dont le geôlier est éternel.

Le bruit des voix autour de moi m’effleure à peine. C’est leur réalité, bien différente de la mienne. Ils parlent, murmurent même, me regardent d’un œil mêlé de pitié et d’incompréhension. Je perçois leurs jugements silencieux, leurs tentatives désespérées de rationaliser ce qu’ils appellent ma folie. Pauvres âmes ignorantes. Ils ne doivent jamais comprendre ce que j’ai vu, ce que j’ai traversé. Leur salut, comme celui de leur âme, repose dans cette ignorance bénie.
Mon regard erre, attiré par Dupois. Ses lèvres bougent à peine, mais les mots qui en sortent — pour eux insignifiants — résonnent en moi avec une clarté terrifiante : “Azathoth”, souffle-t-il. Ses yeux s’évitent les miens, pourtant il sait. Il a vu, il a frôlé cette vérité effrayante qui consume, mais il a eu la sagesse de reculer à temps. Je lui souris, un sourire glacé, dénué d’humanité. Je comprends, et il comprend que je sais. Mais il vivra. Il continuera, là où je ne le peux plus.
Les autres ne sont que des ombres mouvantes autour de moi. Je les ignore. Tous, sauf Pressis. D’un geste presque amical, il me tape doucement sur l’épaule, ce qui m’arrache un frisson étrange. C’est lui. C’est à lui que je vais confier ce journal, mon dernier témoignage, ma confession. Il portera ces mots à ma famille, comme un dernier lien fragile avec une humanité qui m’a désormais échappé.

En traçant ces lignes, une part infime de moi trouve une sorte de soulagement. Peut-être est-ce l’idée que mon sacrifice — car c’est ainsi qu’ils le nommeront, bien que je le voie comme une libération — servira un but. Peut-être ces mots, bien que fous, leur permettront de comprendre à leur tour l’invisible lutte qui se joue.
Car tout est clair maintenant. Ou est-ce une illusion ? La vérité, quand elle nous est révélée, trouble autant qu’elle éclaire. J’entrevois mon avenir, aussi limpide que le sang sur une lame. Le sergent me dénoncera. Il n’aura pas le choix. Je monterai les marches de l’échafaud, et ma tête roulera sous la lame de la guillotine. Mais ce n’est pas une fin. Ce ne peut être une fin.
Ce sera une libération. Mon esprit s’élèvera alors, rejoignant les sphères cosmiques, le trône du Chaos, et la musique qui résonne encore en moi trouvera enfin son rôle. Non pas un rôle de destruction, mais de déséquilibre. Une cacophonie capable d’enrayer les plans du Docteur Rigaut, d’empêcher l’arrivée d’Azathoth dans ce monde. Ma mort sera leur espoir.
Pour le reste, je ne vois pas clairement. Peut-être est-ce l’œuvre de mon imagination. Mais dans cette symphonie d’horreur et de folie, j’ose espérer que mon sacrifice apportera une chance au monde, aussi infime soit-elle. Peut-être même, qui sait, un repos éternel m’attend. Ou bien, une éternité de supplice. Mais cela n’a plus d’importance.
Ma mission est achevée. Que les dieux nous aient en leur miséricorde.
Beaumain,
Un survivant qui n’en est pas un.