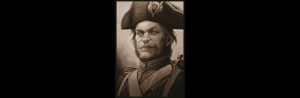17 novembre 1893, 5h40 – Gare de Belgrade
Le sommeil m’avait enfin emporté dans ses bras miséricordieux lorsque l’Orient Express effectua son arrêt matinal à Belgrade. C’est donc par le récit de mes compagnons que j’appris les détails de cette séparation définitive avec Ilsa von Hofler et son père dérangé.
Selon leurs témoignages, l’aube naissante de Belgrade s’étirait dans une brume grisâtre qui enveloppait les quais de sa mélancolie slave, transformant les silhouettes en ombres fantomatiques. Le froid piquant de novembre s’insinuait à travers les fissures des manteaux, rappelant brutalement à ceux qui descendirent qu’ils avaient quitté le cocon luxueux de notre train pour retrouver la réalité crue du monde extérieur.
Mes compagnons me rapportèrent comment Ilsa, redevenue elle-même après avoir abandonné son déguisement d’Asiatique mystérieuse, guida avec une efficacité remarquable son père toujours plongé dans les limbes du laudanum vers les hommes qui l’attendaient. Ces inconnus, dont les silhouettes se découpaient avec une précision quasi militaire dans la vapeur des locomotives, semblaient sortis d’un roman d’espionnage plutôt que d’un traité médical. Leurs manteaux sombres, leurs chapeaux melon tirés bas sur leurs visages impassibles, tout en eux respirait la discrétion professionnelle et l’efficacité germanique.
Le Baron Leopold, d’après leurs observations, offrait dans son état de semi-conscience artificielle un spectacle à la fois pathétique et troublant. Sa silhouette décharnée, soutenue par deux hommes robustes, évoquait irrésistiblement l’image d’un prophète déchu que l’on conduit vers son exil. Ses yeux, quand ils s’entrouvraient parfois, conservaient cette lueur vacillante qui caractérisait son regard d’homme ayant contemplé l’ineffable, mais elle semblait désormais voilée par les brumes chimiques du sédatif.
Robie me confia qu’Ilsa s’était tournée vers notre groupe une dernière fois avant que le petit cortège ne disparaisse dans les méandres de la gare. Son regard, où se mêlaient gratitude et inquiétude résiduelle, avait transpercé mes compagnons avec une intensité qui trahissait l’ampleur de l’épreuve qu’elle venait de traverser. Quelques mots d’allemand échangés avec ses compagnons, un hochement de tête qui scellait je ne sais quel accord secret, et ils s’étaient évanouis dans les brumes de l’aube serbe, emportant avec eux le Baron et ses terrifiantes connaissances vers les cabinets viennois du docteur Freud.
Cette séparation, bien qu’attendue et planifiée, laissa à mes compagnons un goût d’inachevé particulièrement désagréable qu’ils me transmirent à mon réveil. Car si nous avons neutralisé temporairement un danger manifeste en la personne du Baron, nous nous sommes également privés d’un allié potentiel dans notre lutte contre des forces dont nous commençons à peine à entrevoir l’ampleur véritable. Cette réflexion m’accompagne tandis que nous regagnons les voitures luxueuses de l’Orient Express, où d’autres préoccupations nous attendent.
Le cas d’Elizabeth Myers, cette malheureuse veuve que le destin a jetée sur notre route au moment le plus tragique de son existence, constitue désormais notre préoccupation la plus immédiate et la plus déchirante. La pauvre femme, depuis qu’elle a assisté à la transformation hideuse de son époux en créature abominable, demeure plongée dans un état de stupeur catatonique qui défie toutes nos tentatives de réconfort.
Ses yeux, autrefois animés de cette mélancolie résignée que nous lui connaissions, ne sont plus que deux lacs immobiles reflétant un paysage intérieur dévasté par l’horreur. Roulée en position fœtale sur la banquette de notre compartiment, elle semble avoir régressé vers un état primitif de protection instinctive contre un monde devenu soudainement incompréhensible et menaçant.
C’est dans ce contexte que Hervé, animé des meilleures intentions du monde mais manifestement dépassé par l’ampleur du défi psychologique qui se présente à lui, tente une approche qu’il qualifie pompeusement de “psychanalytique”. Son initiative, qui témoigne d’une générosité d’âme que je ne peux que saluer, s’avère hélas catastrophique dans son exécution pratique.
Notre brave détective, avec cette maladresse touchante qui le caractérise dans ses rapports sociaux, entreprend de “faire parler” Miss Myers en lui posant des questions d’une naïveté confondante. “Racontez-moi vos souvenirs d’enfance”, déclame-t-il avec l’assurance d’un praticien chevronné, “libérez votre esprit des traumatismes qui l’encombrent”. Cette approche, digne des plus médiocres manuels de vulgarisation psychologique, ne produit naturellement aucun effet si ce n’est d’accentuer l’agitation de la malheureuse.
Devant l’échec patent de cette méthode improvisée, nous nous résolvons, non sans réticence, à recourir aux bienfaits paradoxaux de l’opium d’Alfred. Cette solution, que notre ingénieur en génie civil propose avec l’expertise malheureuse de l’utilisateur régulier, nous répugne collectivement mais s’impose comme la seule voie possible pour apaiser les souffrances de Miss Myers.
La pipe, préparée avec un soin méticuleux par Alfred dont les gestes trahissent une familiarité que je préférerais ne pas observer, produit sur notre patiente un effet aussi immédiat que troublant. Sous l’influence du narcotique, ses traits crispés par l’angoisse se détendent progressivement, ses respirations saccadées retrouvent un rythme plus régulier, et bientôt une forme de paix artificielle s’empare de son visage ravagé.
Cette accalmie chimique, bien qu’elle nous soulage momentanément de la vision de ses souffrances, ne fait qu’ajourner le problème fondamental : que faire de cette femme brisée par des événements qui dépassent l’entendement humain ? Comment la réintégrer dans une société qui ignore tout des horreurs cosmiques auxquelles elle a été confrontée ?
17 novembre 1893, 11h00 – Arrêt de Nils
L’Orient Express marque une halte technique à Nils, petite bourgade balkanique dont l’architecture mélange influences ottomanes et aspirations occidentales dans un syncrétisme architectural des plus pittoresques. Cette pause m’offre l’occasion de plonger corps et âme dans l’étude approfondie du livre maudit, “Les Murmures du Fez”, dont la possession commence à exercer sur moi une fascination que je m’efforce de qualifier de purement intellectuelle.
Bien à l’abri dans notre compartiment, loin de tout regard indiscret qui pourrait s’alarmer de me voir consulter un tel grimoire, je me consacre avec une méticulosité d’orfèvre à l’examen de cet ouvrage qui a coûté tant de vies. L’ouvrage, que j’ai maintenant l’occasion d’étudier dans des conditions plus favorables que lors de nos affrontements nocturnes, révèle progressivement ses secrets avec une parcimonie calculée qui évoque les révélations graduelles d’un oracle antique.
La première partie, rédigée dans un mélange de langues anciennes que mes connaissances linguistiques me permettent de déchiffrer partiellement, traite effectivement des “usages du Fez Rouge Sang et de ses propriétés”, comme l’indique son titre. Les passages que je parviens à traduire avec une certaine confiance évoquent des rituels d’invocation, des procédures de manipulation mentale, et surtout, des méthodes pour “invoquer Yog-Sothoth” et “obtenir beaucoup de pouvoir”.
Ces révélations, bien qu’elles confirment nos pires soupçons concernant la nature véritable de ces artefacts, ne m’apportent guère de surprise fondamentale. Nous savions déjà, par nos expériences directes et les témoignages recueillis, que les Fez constituaient des instruments de corruption mentale et de manipulation occulte. Ce que le livre m’enseigne, c’est plutôt la systématisation de ces pratiques, leur codification en une méthode reproductible par quiconque posséderait les connaissances appropriées.
Mais cette facilité relative de compréhension ne concerne que la surface de l’ouvrage, sa partie la plus accessible à l’intelligence humaine conventionnelle. Car au-delà de ces révélations déjà troublantes s’étend un territoire intellectuel bien plus périlleux, nécessitant des clés de déchiffrement que je ne possède pas. La véritable essence du livre, ses enseignements les plus profonds et les plus dangereux, demeurent pour l’instant hors de ma portée.
Il me faudrait, pour progresser davantage dans cette étude maudite, des dictionnaires spécialisés, des ouvrages de référence en langues mortes, peut-être même des grimoires complémentaires qui éclaireraient les zones d’ombre de celui-ci. Cette frustration intellectuelle, loin de me décourager, ne fait qu’attiser ma curiosité avec une intensité qui commence à m’inquiéter moi-même.
Quant à la seconde partie du livre, celle qui recèle ces caractères impossibles dont la simple contemplation provoque en moi des sensations si troublantes, elle demeure totalement impénétrable. Ces symboles, qui semblent appartenir à une forme de communication transcendant les limites de l’esprit humain, me narguent depuis leurs pages jaunies avec l’arrogance silencieuse de l’incompréhensible.
Peut-être le professeur Demir, avec son érudition légendaire dans les domaines occultes, pourrait-il m’aider à percer ces mystères. Cette perspective d’une collaboration savante avec l’un des plus grands spécialistes européens de l’ésotérisme oriental éveille en moi un enthousiasme que je m’efforce de tempérer par des considérations plus pragmatiques.
17 novembre 1893, Après-midi – Débat concernant Miss Myers
La question d’Elizabeth Myers revient hanter nos discussions avec la régularité d’un refrain obsédant. Chaque kilomètre qui nous rapproche de Constantinople rend plus urgente la nécessité de trouver une solution à son cas, et nos débats, d’abord feutrés, prennent progressivement l’ampleur de véritables conseils de guerre moraux.
La proposition qui finit par s’imposer, après des heures de délibération douloureuse, consiste à faire interner Miss Myers dans un sanatorium lors de notre arrêt à Sofia. Cette décision, que nous adoptons avec la répugnance de chirurgiens contraints d’amputer un membre pour sauver le patient, s’accompagne d’un plan plus ambitieux : j’enverrai un câble à Ilsa von Hofler pour organiser son rapatriement vers les soins du professeur Freud.
L’idée de confier Miss Myers aux mêmes mains expertes qui s’occupent désormais du Baron possède une logique indéniable. Si les délires du père von Hofler et les traumatismes de notre protégée relèvent bien de la même catégorie de troubles mentaux – ceux causés par la confrontation avec l’ineffable – alors qui mieux que le révolutionnaire praticien viennois pourrait les traiter avec les méthodes appropriées ?
Cette perspective représente pour Miss Myers une chance de guérison que nous ne pourrions lui offrir par nos propres moyens. Car que sommes-nous, au fond, sinon des amateurs bien intentionnés mais cruellement dépourvus des compétences nécessaires pour soigner des blessures psychiques d’une telle profondeur ? Notre bonne volonté, si sincère soit-elle, ne saurait remplacer l’expertise médicale spécialisée.
18 novembre 1893 – Sofia : L’Épreuve de la bureaucratie corrompue
Hélas, comme tant de nos projets élaborés dans l’optimisme de la théorie, celui-ci se heurte brutalement à la réalité sordide de l’administration balkanique. L’arrêt à Sofia, que nous avions envisagé comme une halte salvatrice, se transforme en un cauchemar bureaucratique qui teste les limites de ma patience et de ma diplomatie.
Les douaniers bulgares, incarnation parfaite de cette petite tyrannie administrative qui fleurit dans les interstices des grands empires, manifestent un zèle procédurier qui confine à l’obstruction systématique. Ces fonctionnaires, dont l’autorité mesquine semble inversement proportionnelle à leur stature intellectuelle, refusent catégoriquement de nous laisser débarquer Miss Myers sans une avalanche de documents qu’ils savent pertinemment impossibles à produire dans les délais impartis.
Leur attitude, mélange de corruption à peine voilée et de sadisme bureaucratique, éveille en moi une colère que je m’efforce de canaliser vers des fins constructives. Car derrière leurs sourires faux et leurs hochements de tête hypocrites, je perçois clairement l’attente de cette gratification financière qui seule pourra huiler les rouages grippés de leur administration.
Le pot-de-vin, bien qu’il répugne à mes principes journalistiques et citoyens, devient rapidement une nécessité tactique. Quelques pièces d’or, discrètement glissées dans les mains appropriées, transforment miraculeusement l’inflexibilité réglementaire en bienveillante compréhension. Cette corruption, si révoltante soit-elle, nous permet enfin d’obtenir l’autorisation de faire venir un médecin pour examiner Miss Myers.
Mais notre soulagement se révèle prématuré lorsque arrive le praticien désigné par les autorités locales. L’homme qui se présente devant nous défie toute définition charitable de la compétence médicale. Sa mise débraillée, ses mains crasseuses, son haleine vineuse – tout en lui suggère plutôt le charlatan de foire que le disciple d’Hippocrate.
Plus alarmant encore, cet individu d’apparence douteuse se révèle être un simple généraliste de campagne, totalement dépourvu de toute connaissance spécialisée dans les troubles mentaux. Sa proposition de “traitement” – quelques sangsues et un purgatif énergique – témoigne d’une conception de la médecine qui aurait paru archaïque au siècle précédent.
Face à cette mascarade médicale, ma conscience se rebelle avec une véhémence qui me surprend moi-même. Comment pourrais-je abandonner Miss Myers entre les mains de ce pseudo-praticien, sachant les souffrances supplémentaires qu’une telle négligence ne manquerait pas de lui infliger ? L’idée même de laisser cette femme déjà martyrisée par le destin subir en plus les sévices d’une médecine incompétente me devient physiquement insupportable.
Cette réaction viscérale, cette impossibilité morale d’abandonner Miss Myers à son sort, m’étonne par son intensité. Moi qui me targue habituellement d’un pragmatisme journalistique face aux situations difficiles, je me découvre incapable du détachement nécessaire pour sacrifier un individu au bien supposé du plus grand nombre.
Peut-être cette sensibilité nouvelle provient-elle de ma culpabilité latente concernant les événements qui ont conduit à la mort de son époux. Aurais-je pu, par quelque décision différente, éviter la transformation abominable de Myers ? Cette question, que je n’ose formuler explicitement, ronge ma conscience avec la persistance d’un remords inavoué.
Ou peut-être cette émotion reflète-t-elle une évolution plus profonde de ma personnalité, une humanisation progressive causée par ma confrontation répétée avec l’inhumain. Face aux horreurs cosmiques que nous affrontons, la solidarité avec nos semblables pourrait bien représenter notre dernier rempart contre la folie et la déshumanisation.
Quoi qu’il en soit, je ne peux me résoudre à abandonner Miss Myers dans cette bourgade perdue entre les mains d’incompétents. Nous remontons donc dans l’Orient Express, emmenant avec nous cette femme brisée et l’immense responsabilité morale qu’elle représente. Mon télégramme à Ilsa von Hofler, envoyé depuis la gare de Sofia, organise désormais son rapatriement depuis Istanbul – solution moins élégante mais infiniment plus humaine.
18 novembre 1893, Nuit – Tourments et révélations ancestrales
La nuit qui suit ces événements éprouvants se révèle particulièrement agitée, peuplée de songes troublants et de méditations douloureuses qui refusent de me laisser en paix. Les étoiles des Balkans, observées depuis la fenêtre de notre compartiment, semblent pulser avec une fréquence qui évoque les battements d’un cœur cosmique, projetant sur le paysage nocturne des ombres mouvantes qui prennent parfois des formes inquiétantes.
Le souvenir du Turc que j’ai abattu dans le couloir de l’Orient Express me hante avec une persistance que je n’avais pas anticipée. Ce n’est pas tant l’acte lui-même qui me trouble – car face au danger mortel qu’il représentait, je n’avais guère d’alternative – mais plutôt ses implications philosophiques plus larges.
En pressant la détente de mon revolver, j’ai franchi une ligne invisible qui sépare l’observateur de l’acteur, le chroniqueur du protagoniste. Cette métamorphose, aussi nécessaire ait-elle été dans les circonstances, m’a révélé des aspects de ma personnalité que je préférais ignorer. Suis-je vraiment cet homme de plume pacifique que je croyais être, ou portais-je déjà en moi, à l’état latent, cette capacité à la violence que les événements n’ont fait qu’actualiser ?
Cette interrogation sur ma propre nature se mêle à des réflexions plus vastes concernant le destin qui semble nous guider inexorablement vers des révélations toujours plus troublantes. Car plus j’approfondis mes souvenirs du journal de mon ancêtre et plus je compare ses aventures révolutionnaires aux nôtres, plus s’impose à moi la conviction que nous sommes les maillons d’une chaîne temporelle dont les extrémités se perdent dans l’obscurité des âges.
Le nom de Yog-Sothoth, cette entité primordiale que mon aïeul le soldat Beaumain avait déjà affrontée dans les chaos de la Révolution française, résonne maintenant dans mes recherches actuelles avec une persistance qui défie toute explication rationnelle. Comment un être cosmique d’une telle ancienneté pourrait-il manifester un intérêt si particulier et si constant pour notre lignée familiale ?
Cette question, qui tourmente mes nuits avec l’obsession d’un leitmotiv musical, suggère l’existence d’un lien ancestral dont la nature m’échappe encore. Sommes-nous, nous autres Beaumain, marqués par quelque malédiction héréditaire qui nous désigne comme instruments de ces puissances indicibles ? Ou au contraire, portons-nous en nous une forme de résistance particulière qui fait de nous des adversaires naturels de ces entités ?
Mes souvenirs du journal de mon ancêtre, ressassés dans l’obscurité de notre compartiment, révèlent de nouveaux détails troublants à chaque fois que j’y repense. Des passages que j’avais d’abord attribués au délire fiévreux d’un esprit dérangé par les horreurs révolutionnaires prennent maintenant une dimension prophétique qui me glace le sang.
Mes propres aventures semblent reproduire, avec un siècle d’écart, les épreuves qu’il a traversées d’après mes souvenirs de ses écrits. Cette reproduction, trop fidèle pour être fortuite, suggère l’existence d’un dessein cosmique qui transcende les générations humaines et manipule nos existences individuelles comme les pièces d’un échiquier métaphysique.
Cette prise de conscience du caractère probablement inéluctable de notre confrontation avec l’ineffable, loin de me décourager, renforce paradoxalement ma détermination. Si le destin a effectivement tissé nos vies dans la trame de ce conflit cosmique, alors nous n’avons d’autre choix que d’assumer pleinement notre rôle, quelles qu’en soient les conséquences pour notre intégrité physique et mentale.
Car je porte désormais une responsabilité qui dépasse ma seule personne. Les sacrifices de mon ancêtre, les souffrances de Miss Myers, les dangers auxquels mes compagnons s’exposent en me suivant dans cette quête – tout cela exige de moi un engagement total, une abnégation qui ne tolère aucune défaillance.
Cette nuit d’insomnie et de méditation me laisse épuisé au matin, mais également purifié d’une certaine manière. Les doutes et les hésitations qui m’assaillaient encore la veille se sont cristallisés en une résolution ferme : nous irons jusqu’au bout de cette aventure, quoi qu’il nous en coûte personnellement.
19 novembre 1893, 11h00 – Arrivée à Istanbul
La gare de Sirkeci, terminus légendaire de l’Orient Express, nous accueille dans un concert de sifflements de vapeur et de cris en turc qui forment une symphonie orientale d’une beauté sauvage. Le soleil de novembre, filtré par les brumes du Bosphore, projette sur les coupoles et les minarets de la ville une lumière dorée qui transforme Istanbul en un mirage architectural flottant entre deux continents.
C’est dans ce décor de splendeur ottomane que nous faisons la connaissance de Toprak et Rana Demir, les enfants du professeur que nous sommes venus rencontrer. Ces deux jeunes gens, dont l’apparence trahit immédiatement l’éducation occidentale mêlée aux traditions orientales, nous abordent avec une politesse exquise qui masque mal une anxiété profonde.
Toprak, le fils aîné, présente cette prestance naturelle que confère une éducation privilégiée. Sa moustache soigneusement taillée, ses vêtements de coupe européenne, son port aristocratique – tout en lui évoque ces jeunes Ottomans de la nouvelle génération qui tentent de concilier héritage ancestral et modernité occidentale. Son anglais, bien qu’empreint d’un accent chantant qui trahit ses origines, témoigne d’une maîtrise linguistique remarquable.
Rana, sa sœur, dégage cette beauté orientale mystérieuse que les peintres européens s’épuisent à capturer sans jamais y parvenir pleinement. Ses yeux noirs, d’une profondeur qui évoque les puits anciens de l’Anatolie, nous scrutent avec une intelligence perçante qui n’a rien à envier à celle de son frère. Sa mise, savant mélange d’influences ottomanes et parisiennes, témoigne d’un goût raffiné et d’une conscience aiguë des codes sociaux de notre époque.
Églantine, avec cette perspicacité féminine qui la caractérise, remarque immédiatement ce que nos yeux moins exercés aux subtilités psychologiques auraient pu manquer : “Leur regard sombre derrière leur sourire”, comme elle le formulera plus tard avec cette précision poétique qui lui est propre. Cette observation, apparemment anodine, révèle une vérité plus profonde sur l’état d’esprit de nos hôtes.
Car derrière leur accueil chaleureux et leurs sourires de bienvenue, on perçoit effectivement l’ombre de préoccupations graves qui assombrissent leurs traits juvéniles. Cette gravité latente ne tarde pas à trouver son explication lorsque, après quelques échanges de politesse, les deux jeunes gens finissent par avouer la terrible vérité qui les tourmente.
La nuit précédente, nous apprennent-ils avec des voix où perce une émotion difficilement contenue, leur demeure familiale a été attaquée par des inconnus. Leur père, le professeur Demir, a été poignardé au ventre et se trouve actuellement en convalescence, affaibli par sa blessure mais heureusement hors de danger immédiat. Plus dramatique encore, leur plus jeune frère Barlas a été enlevé alors qu’il tentait courageusement de porter secours à son père blessé.
Ces révélations, livrées d’une voix tremblante par Rana tandis que Toprak serre les poings avec une rage contenue, transforment instantanément notre compréhension de la situation. Nous ne sommes plus de simples visiteurs venus consulter un érudit, mais des témoins involontaires d’un drame familial qui s’inscrit manifestement dans la continuité de nos propres aventures.
Cette synchronicité troublante, cette coïncidence entre notre arrivée et l’attaque nocturne, ne peut être fortuite. Nos ennemis, loin d’avoir été neutralisés par notre victoire à bord de l’Orient Express, semblent avoir devancé notre arrivée à Istanbul, frappant préventivement celui qui représentait notre meilleur espoir de comprendre et de combattre les forces occultes que nous affrontons.
Le télégramme d’Ilsa von Hofler, qui m’attend à la poste de la gare, constitue une heureuse surprise dans ce contexte d’inquiétude croissante. Sa décision de venir personnellement à Istanbul pour s’occuper de Miss Myers témoigne d’une générosité d’âme qui rachète largement les manipulations auxquelles elle s’est livrée à bord du train. Cette nouvelle allège considérablement le fardeau moral que représentait pour moi l’avenir incertain de notre protégée.
Nos nouveaux amis nous guident ensuite à travers le labyrinthe fascinant d’Istanbul, cette ville où se mêlent avec une harmonie parfaite les héritages de trois empires successifs. Les charrettes qu’ils ont fait venir pour nous transporter offrent un point de vue privilégié sur cette métropole unique, où les coupoles byzantines côtoient les minarets ottomans et où les façades vénitiennes se reflètent dans les eaux éternelles du Bosphore.
Toprak se révèle être un guide érudit et passionné, nous livrant au fil de notre parcours urbain une leçon d’histoire architecturale improvisée. Mais je perçois dans son enthousiasme apparent une forme de dérivation anxieuse, comme s’il cherchait à retarder le moment des révélations difficiles qui nous attendent.
Rana, plus silencieuse mais non moins attentive, observe nos réactions avec cette acuité particulière des femmes orientales éduquées dans la tradition de l’observation discrète. Son regard, quand il croise le mien, semble jauger notre capacité à affronter les épreuves qui se profilent, évaluant notre solidité morale avec la perspicacité d’un médecin examinant un patient.
La traversée du Bosphore constitue un moment de pure beauté qui suspend temporairement nos préoccupations terrestres. Le détroit, cette frontière liquide entre l’Europe et l’Asie, déploie sous nos yeux éblouis un panorama d’une splendeur intemporelle. Les eaux sombres, striées par le sillage de notre embarcation, reflètent les palais ottomans et les mosquées impériales avec une fidélité qui transforme la réalité en mirage.
Cette beauté transcendante, cette harmonie parfaite entre l’œuvre humaine et la nature, me rappelle cruellement la fragilité de notre civilisation face aux forces cosmiques que nous combattons. Combien de temps encore cette splendeur millénaire résistera-t-elle si les cultistes parviennent à leurs fins apocalyptiques ?
19 novembre 1893, Après-midi – La demeure des Demir et les premières révélations
La résidence du professeur Demir, située dans le quartier aristocratique de Galata, témoigne immédiatement du raffinement intellectuel et de la prospérité de ses occupants. Cette belle demeure, qui marie avec un bonheur architectural rare les traditions ottomanes et les innovations européennes, s’élève sur trois niveaux autour d’une cour intérieure ornée d’une fontaine dont le murmure cristallin accueille les visiteurs.
L’architecture elle-même raconte l’histoire d’une famille qui a su naviguer avec succès entre les écueils de la modernisation et les exigences du respect traditionnel. Les moucharabiehs finement sculptés côtoient des fenêtres à l’européenne, les tapis d’Ispahan se mêlent aux meubles de style Empire, créant un ensemble d’une harmonie surprenante qui reflète l’esprit cosmopolite de ses habitants.
Selin Demir, l’épouse du professeur, nous accueille avec cette grâce naturelle qui caractérise les femmes ottomanes de haute éducation. Sa beauté, rehaussée par le port altier que confère une lignée aristocratique, s’accompagne d’une intelligence qui brille dans ses yeux sombres. Son français, d’une pureté remarquable, témoigne d’une éducation soignée qui ne doit rien envier à celle des salons parisiens.
Mais c’est la rencontre avec le professeur Hamed Demir lui-même qui constitue le moment fort de cette première journée stambouliote. L’homme qui s’avance vers nous, malgré sa blessure récente et la douleur visible qu’elle lui cause, dégage immédiatement cette aura d’autorité intellectuelle qui caractérise les grands érudits.
Sa silhouette imposante – il mesure effectivement cette taille remarquable d’un mètre quatre-vingts qui le distingue de ses contemporaires – porte avec dignité les marques de l’épreuve qu’il vient de traverser. Son profil, d’une noblesse qui évoque les médailles antiques, encadre une moustache fournie qui lui confère cette prestance orientale si prisée par les peintres romantiques.
Mais ce qui frappe le plus chez le professeur Demir, au-delà de son apparence physique remarquable, c’est cette jovialité authentique qu’il manifeste malgré les “événements fâcheux de la nuit précédente”, selon sa propre expression pleine de pudeur britannique. Cette capacité à maintenir l’hospitalité orientale traditionnelle face à l’adversité témoigne d’une grandeur d’âme qui force immédiatement le respect.
L’invitation à résider dans leur demeure, formulée avec cette sincérité chaleureuse qui caractérise la vraie générosité, nous touche profondément. Dans un monde où les intérêts personnels semblent régir la plupart des relations humaines, cette ouverture désintéressée constitue un baume pour nos âmes éprouvées par tant de duplicité et de violence.
Le rituel du partage des fruits et du “verre de l’amitié” nous plonge immédiatement dans l’atmosphère de confiance mutuelle nécessaire aux confidences graves. Cette cérémonie, apparemment simple mais chargée de significations symboliques profondes dans la culture ottomane, scelle notre alliance naissante avec une solennité discrète mais réelle.
C’est dans ce contexte de confiance établie que je livre au professeur Demir un résumé exhaustif des événements qui nous ont menés jusqu’à lui. Mon récit, aussi précis que me le permettent les circonstances extraordinaires de notre aventure, couvre nos confrontations londoniennes, nos épreuves à bord de l’Orient Express, et finalement notre victoire sanglante sur Menkaph et sa délégation.
Le professeur écoute mes révélations avec cette attention soutenue que seuls savent manifester les érudits habitués aux récits extraordinaires. Son visage, quoique grave, ne trahit ni incrédulité ni surprise excessive, suggérant que nos mésaventures s’inscrivent dans un cadre conceptuel qu’il maîtrise déjà partiellement.
Lorsque j’évoque la mort de Menkaph et la récupération du livre maudit, ses yeux s’illuminent d’un éclat qui trahit l’importance cruciale qu’il attache à ces développements. Mais cette satisfaction se mêle immédiatement à une inquiétude profonde lorsqu’il évoque plus en détail les événements dramatiques de la nuit précédente que ses enfants nous avaient déjà brièvement rapportés.
Les détails supplémentaires que nous livre maintenant le professeur sur cette attaque nocturne révèlent l’ampleur d’une conspiration bien plus vaste et mieux organisée que nous ne l’avions imaginé.
Ce jeune Barlas, dont les portraits éparpillés dans le salon révèlent un adolescent au regard vif et intelligent, avait donc fait preuve d’un courage remarquable en tentant de protéger son père face à des assaillants mystérieux. Cette image du fils défendant son géniteur face au danger éveille en moi des échos douloureux de mes propres relations familiales et de l’héritage ancestral qui pèse sur mes épaules.
Le message de Nisra, cette mystérieuse “Fille du Destin” dont le nom revient sans cesse dans les récits concernant le culte, constitue un ultimatum d’une clarté brutale. Vingt-quatre heures pour remettre le livre et les Fez en notre possession ET quitter Istanbul définitivement – telles sont les conditions non négociables pour obtenir la libération du jeune Barlas. Cette série d’exigences cumulatives, formulée avec la simplicité tranchante d’un couperet, ne laisse guère place à l’interprétation ou à la négociation.
Mais c’est le déluge d’informations qui suit ces révélations initiales qui achève de bouleverser notre vision de l’affaire. Le professeur Demir, avec cette générosité intellectuelle qui caractérise les vrais savants, partage avec nous le fruit de ses recherches sur les cultes impliqués dans cette sinistre machination.
Nos adversaires, loin de constituer une secte marginale animée par quelques fanatiques isolés, s’avèrent être un réseau complexe et ramifié dont les tentacules s’étendent bien au-delà de ce que nous avions soupçonné. La découverte de l’existence de cultes rivaux – les “Enfants du Fez Rouge Sang” d’un côté et les “Frères de la Chair” de l’autre – révèle une dimension géopolitique occulte qui dépasse largement nos aventures personnelles.
Cette scission entre Menkaph et Selim Makryat, ces deux figures démiurgiques qui se disputent l’hégémonie sur les forces ténébreuses, suggère que notre élimination du premier n’a fait qu’éliminer l’une des têtes de l’hydre. Loin de résoudre le problème, notre victoire à bord de l’Orient Express semble avoir simplement modifié l’équilibre des forces en présence.
Le portrait que dresse le professeur de Nisra, cette “Fille du Destin” qui se dissimule derrière Menkaph, révèle une personnalité d’une complexité psychologique fascinante et terrifiante. Cette femme, “proche de la folie” selon les termes choisis de Demir, incarne cette corruption particulière qui résulte de l’exposition prolongée aux savoirs interdits.
Sa formation auprès du mystérieux “Prince Puzzle” – ce Jean Floressas des Esseintes dont le nom aristocratique ne parvient pas à masquer la perversité fondamentale – explique sans doute cette “dépravation et déviation du mal” qui caractérise sa personnalité actuelle. Cette filiation intellectuelle maudite, cette transmission de génération en génération des connaissances les plus dangereuses, illustre parfaitement les mécanismes par lesquels l’humanité se corrompt au contact de l’ineffable.
Quant à Selim Makryat et son culte de “l’Écorché”, ils représentent une menace d’une nature différente mais non moins inquiétante. Cette entité mystérieuse, dont le simple nom évoque des pratiques d’une brutalité révoltante, suggère l’existence de traditions occultes encore plus anciennes et plus sauvages que celles auxquelles nous avons été confrontés jusqu’à présent.
19 novembre 1893, Soirée – Le moment de vérité face au livre maudit
C’est au terme de cet après-midi riche en révélations que se produit l’événement le plus troublant de notre séjour stambouliote : le moment où le professeur Demir me demande de lui remettre le livre des “Murmures du Fez”. Cette requête, pourtant parfaitement logique et attendue dans les circonstances, provoque en moi une réaction d’une étrangeté qui m’ébranle jusqu’aux fondements de ma conscience.
Pour la première fois depuis que j’ai posé mes mains sur ce grimoire maudit, l’idée de m’en séparer me traverse l’esprit. Et à ma stupéfaction la plus complète, cette perspective éveille en moi une résistance viscérale que je ne parviens pas à expliquer rationnellement. Moi qui n’avais jamais envisagé de conserver cet ouvrage dangereux, je me découvre incapable de prononcer un “oui” franc et massif face à la demande légitime du professeur.
Cette hésitation inexplicable, cette réticence qui semble sourdre des profondeurs de mon être sans passer par le filtre de ma raison, me révèle avec une clarté terrifiante l’étendue de l’influence que le livre a déjà exercée sur moi. Car si je ne parviens pas à dire simplement “oui” à celui qui représente manifestement nos meilleurs espoirs de comprendre et de neutraliser ces artefacts maudits, c’est que quelque chose en moi s’oppose à cette séparation.
Au lieu de l’acquiescement immédiat que la situation exige, je me surprends à marchander, à négocier les termes de cette transmission. “Naturellement, professeur”, entends-je ma voix déclarer avec une assurance feinte, “mais j’aimerais beaucoup participer à vos recherches. Ce livre recèle tant de mystères que notre collaboration pourrait s’avérer mutuellement bénéfique.”
Cette proposition, formulée avec l’habileté diplomatique que m’ont enseignée mes années de journalisme, masque mal la véritable nature de ma réticence. Car ce que je n’ose avouer, même à moi-même, c’est que l’idée de perdre l’accès à ce grimoire me cause une angoisse profonde et irrationnelle.
L’analyse de ma propre réaction m’épouvante bien plus que tous les phénomènes surnaturels auxquels j’ai été confronté jusqu’à présent. Car elle révèle que ces “tentacules maudites” ont déjà commencé à s’insinuer dans mon esprit, tissant leurs fils invisibles dans les replis de ma conscience avec une subtilité qui défie toute détection.
Cette paranoia naissante, cette méfiance soudaine envers un homme qui incarne pourtant tout ce que nous cherchons – l’érudition, la sagesse, l’expérience des forces occultes – témoigne d’une corruption mentale qui progresse sournoisement en moi. Suis-je en train de devenir l’une de ces victimes de l’influence des artefacts, comme Matthews Pook ou le Baron von Hofler avant moi ?
Cette prise de conscience, aussi terrifiante soit-elle, provoque en moi un sursaut de lucidité salvatrice. Je reconnais dans ma résistance à céder le livre les premiers symptômes de cette addiction métaphysique qui transforme progressivement les chercheurs en esclaves de leurs propres recherches. Le pouvoir que confère la connaissance des arcanes interdits exerce une séduction d’autant plus dangereuse qu’elle se présente sous les dehors respectables de la curiosité intellectuelle.
Pourtant, même armé de cette compréhension théorique de ma situation, je ne parviens pas à surmonter entièrement ma réticence. Une voix intérieure, que je ne reconnais pas comme entièrement mienne, continue de me susurrer que cette collaboration avec Demir représente la seule voie pour approfondir ma compréhension des mystères cosmiques qui nous entourent.
Cette rationalisation, si séduisante en apparence, dissimule mal l’avidité spirituelle qui la motive véritablement. Car au-delà de ma soif légitime de connaissance et de ma volonté sincère de contribuer à la lutte contre ces forces maléfiques, je perçois maintenant cette attraction morbide pour le pouvoir que confèrent les savoirs interdits.
Suis-je encore capable de résister à cette séduction, ou suis-je condamné à suivre le même chemin que tous ceux qui ont succombé avant moi à l’appel de l’ineffable ? Cette question, qui hante désormais mes pensées avec l’obsession d’un leitmotiv musical, révèle l’ampleur du défi psychologique qui m’attend.
L’étude du livre maudit, que j’envisageais initialement comme un moyen de défense contre nos ennemis, se révèle être également un péril pour mon intégrité mentale. Cette double nature de la connaissance occulte – simultanément arme et poison, protection et corruption – illustre parfaitement les dilemmes moraux auxquels nous confronte notre quête.
Alors que la nuit tombe sur Istanbul, transformant les coupoles et les minarets en silhouettes fantomatiques découpées contre un ciel étoilé, je contemple l’ampleur des défis qui nous attendent. Car nous ne luttons plus seulement contre des ennemis extérieurs, si redoutables soient-ils, mais également contre cette corruption insidieuse qui menace de nous transformer en ce que nous combattons.
Cette réalisation, loin de me décourager, affine ma détermination d’une manière que je n’aurais pas crue possible. Si nous devons affronter simultanément les cultistes extérieurs et nos propres démons intérieurs, alors notre victoire n’en sera que plus significative. Car triompher de l’ineffable tout en préservant notre humanité constituerait un exploit digne des plus grands héros de l’antiquité.
Le message de Nisra, avec son ultimatum de vingt-quatre heures exigeant que nous remettions les artefacts ET quittions Istanbul, impose à nos délibérations une urgence qui ne tolère aucune tergiversation. Mais avant d’élaborer notre réponse à cette menace, nous devons d’abord prendre le temps d’analyser ensemble toutes ces révélations, de digérer l’ampleur de la conspiration qui nous dépasse, et de forger notre stratégie commune face à des adversaires dont nous commençons seulement à entrevoir la véritable puissance.