16 novembre 1893, 8h30
L’aube s’infiltrait timidement à travers les stores luxueux de notre compartiment lorsque le timbre discret de la sonnerie de réveil rompit le silence ouaté de notre cabine. La veille au soir, j’avais pris soin de commander ce réveil pour huit heures trente, ayant prévu de me rendre dans le wagon-restaurant afin d’y prendre mon petit-déjeuner vers neuf heures. Hélas, comme il devient coutumier dans notre singulière expédition, le privilège de veiller sur le Fez m’échoit une fois de plus, altérant inévitablement mes plans initiaux.
La présence oppressante de l’artefact, dissimulé sous les apparences anodines d’une simple boîte à chapeau, semble néanmoins créer autour de lui une atmosphère de gravité qui transforme notre luxueux compartiment en un sanctuaire improvisé. Acceptant cette modification de programme avec la résignation qu’impose notre mission, je décide de faire porter mon petit-déjeuner dans notre cabine. Tant qu’à jouir de cette solitude forcée et du calme relatif qui l’accompagne, autant mettre ce temps à profit pour œuvrer à notre survie collective par l’étude approfondie des documents en ma possession.
Le plateau argenté qu’apporte le steward en livrée bleu nuit contient une théière fumante, des toasts parfaitement dorés et des œufs dont la préparation impeccable témoigne de l’excellence culinaire qui fait la réputation de l’Orient Express. Pourtant, ces délices gastronomiques m’intéressent moins que les parchemins jaunis et les tomes reliés de cuir que j’extrais méthodiquement de ma serviette. L’Apocryphe du Fez, cette collection fragmentaire de savoirs interdits que nous reconstituons péniblement, s’étale bientôt devant moi, couvrant la petite table escamotable de notre compartiment.
Cette fois, mes recherches s’orientent spécifiquement en fonction des événements terrifiants dont nous avons été témoins la veille au soir. L’apparition spectrale qui semblait émaner du Fez, cette entité ailée composée d’une obscurité substantielle, et surtout, l’incantation que j’ai prononcée sous la pression de l’urgence – tous ces éléments guident désormais ma quête de connaissances dans ce labyrinthe de textes anciens.
Mes doigts parcourent fébrilement les pages, tandis que mon esprit s’efforce de relier entre eux les fragments épars d’un savoir que l’humanité s’est efforcée d’oublier. Au fil des heures, à mesure que le paysage défile derrière la vitre de notre compartiment, une image plus cohérente commence à émerger du chaos apparent de ces documents disparates. Et ce que j’y découvre me glace le sang, tout en confirmant mes pires appréhensions.
Le Fez, cet objet d’apparence si banale dans notre monde moderne, n’est rien moins qu’un instrument de manipulation mentale d’une efficacité terrifiante. Sa malveillance n’opère pas de manière brutale, mais avec l’insidieuse subtilité d’un poison qui s’infiltre goutte à goutte dans l’esprit de sa victime. Il s’insinue progressivement dans les pensées de celui qui le porte, altérant sa perception de la réalité, modifiant imperceptiblement ses valeurs morales, jusqu’à ce que la personnalité originelle ne soit plus qu’un vague souvenir, une coquille vide habitée par la volonté étrangère de l’artefact.
Ce processus de corruption ne se limite pas au seul domaine mental. Les textes décrivent avec une précision clinique qui évoque les traités médicaux les plus modernes la dégénérescence physique qui accompagne inévitablement la transformation mentale. Le corps du porteur subit des modifications progressives mais inexorables, se tordant, se déformant pour accueillir l’essence extraterrestre véhiculée par le Fez. La métamorphose hideuse dont nous avons été témoins à Londres, cette langue démesurée jaillissant de la bouche de Matthew Pook, n’était que l’aboutissement visible d’un processus entamé bien plus tôt, dans les profondeurs invisibles de son organisme.

Mais au milieu de ces descriptions cauchemardesques, un espoir ténu se dessine. Car si le porteur non initié devient rapidement l’esclave de l’artefact, il semble qu’il existe une voie alternative. Certains passages, écrits dans une calligraphie nerveuse qui trahit l’agitation de leur auteur, évoquent la possibilité pour un initié aux arcanes les plus profonds de maîtriser le Fez plutôt que d’être maîtrisé par lui.
Celui qui parviendrait à ce niveau de contrôle pourrait, selon ces textes, utiliser à son gré toutes les capacités de l’artefact. Plus troublant encore, certaines annotations marginales suggèrent qu’un tel maître pourrait exercer ces pouvoirs sans même porter physiquement le Fez. Des allusions obscures évoquent même la possibilité de contrôler à distance, par l’intermédiaire du Fez, la personne qui le porte, créant ainsi une chaîne de domination où l’artefact n’est plus qu’un maillon intermédiaire.
Cette révélation projette une lumière nouvelle sur les événements de la veille. L’apparition spectrale qui a envahi notre compartiment n’était peut-être pas une manifestation autonome du Fez, mais le résultat d’une manipulation consciente et délibérée. À mesure que cette hypothèse prend forme dans mon esprit, une certitude s’impose avec la force d’une évidence : Menkaph est à l’origine de ce phénomène.
Utilise-t-il directement un Fez qu’il porte lui-même ? Cette possibilité, bien que non négligeable, me semble peu probable. Un occultiste de son envergure, s’il a atteint la maîtrise décrite dans ces textes, chercherait vraisemblablement à éviter le contact direct avec un artefact aussi puissant et imprévisible. Mon intuition me porte plutôt vers l’étrange couple qui accompagne la délégation turque – cette femme d’une beauté mélancolique et son jeune compagnon maladif, dont la faiblesse évidente évoque irrésistiblement les symptômes décrits dans l’Apocryphe. Ce malheureux pourrait bien être le porteur involontaire d’une autre instance du Fez maudit, un pantin dont les fils sont tirés par Menkaph à travers l’artefact.
Cette déduction m’amène à reconsidérer les événements de la veille sous un jour plus sombre encore. Car si ma théorie est exacte, cela signifie que ni mon incantation improvisée, ni les prières ferventes d’Églantine n’ont eu d’effet réel sur l’apparition. Notre prétendue victoire n’était qu’une illusion, une représentation théâtrale dont Menkaph tirait les ficelles dans l’ombre. L’entité s’est retirée non pas parce que nous l’avons vaincue, mais parce que son maître l’a rappelée, peut-être satisfait des informations recueillies lors de cette première confrontation.
Cette conclusion me pèse d’autant plus que je n’ai pas le courage de la partager avec Églantine. Lui révéler l’inefficacité probable de ses prières risquerait d’ébranler sa foi, cette force intérieure qui constitue peut-être notre dernier rempart contre les puissances cosmiques que nous affrontons. Dans ce combat inégal contre l’inconcevable, pouvons-nous vraiment nous permettre de sacrifier la moindre parcelle d’espoir, fût-elle fondée sur une illusion ?
Une question cruciale demeure sans réponse : qu’est-ce qui a réellement mis fin à la manifestation d’hier soir, si ce n’était ni mon incantation ni les prières d’Églantine ? La réponse échappe à ma compréhension, mais je pressens qu’elle contient la clé de notre survie face aux épreuves qui nous attendent.
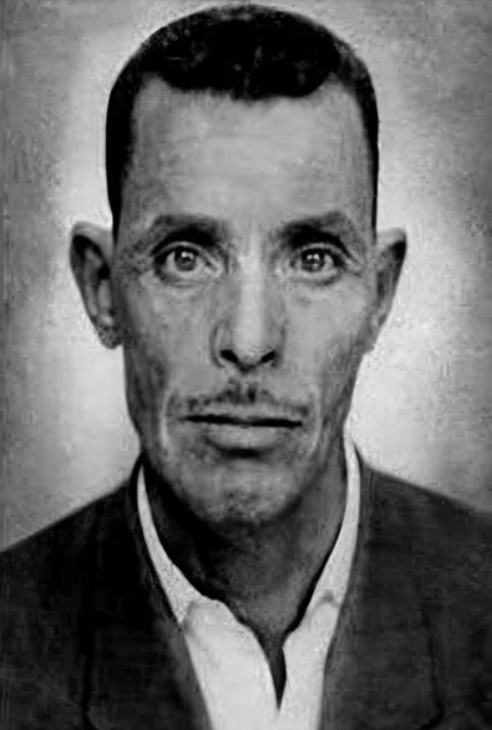
Mes réflexions sont interrompues par le retour de mes compagnons, leur conversation animée précédant leur entrée dans notre compartiment. À leur mine réjouie, je devine que leur petit-déjeuner dans le wagon-restaurant a été plus agréable que mes ruminations solitaires. Cette diversion bienvenue me ramène aux contingences immédiates de notre situation.
Robbie, dont la carrure imposante semble presque incongrue dans l’espace confiné de notre compartiment, m’informe immédiatement d’une nouvelle qui bouscule nos prévisions. À sa grande surprise, il a clairement aperçu Burnham, ce journaliste britannique dont la présence à bord nous avait tant intrigués, descendre du train avec ses bagages lors de notre dernier arrêt. Cette information inattendue ajoute une nouvelle pièce au puzzle déjà complexe que nous tentons d’assembler.
Ma méfiance naturelle, aiguisée par les événements récents, me pousse à m’interroger sur la signification véritable de ce départ précipité. Est-ce une simple coïncidence ? Une manœuvre tactique de Menkaph, qui n’aurait plus besoin de son informateur occidental ? Ou, perspective plus inquiétante encore, un prélude à quelque nouvelle machination dont nous ne percevons pas encore les contours ? L’avenir nous éclairera, sans doute, mais l’expérience m’a appris que la lumière révèle parfois des vérités que l’on préférerait ignorer.
La conversation s’engage bientôt autour des découvertes que j’ai faites pendant leur absence. Je leur expose en détail le fruit de mes recherches et mes réflexions, partageant avec une transparence totale les informations cruciales qui pourraient déterminer notre survie collective. Cette franchise absolue me semble être la moindre des choses envers ces compagnons qui risquent leur vie dans une entreprise dont ils ne mesuraient certainement pas l’ampleur en acceptant l’invitation de Smith.
Mes révélations, notamment celles concernant les “arts noirs” nécessaires à la maîtrise du Fez, se heurtent initialement à la résistance d’Eugène. Ce n’est pas tant une opposition de principe qu’une incapacité conceptuelle à appréhender la véritable nature de ce que j’évoque. Son érudition, bien que considérable, reste ancrée dans un cadre conventionnel qui ne lui permet pas de saisir immédiatement l’essence de ces pratiques ancestrales.
Sa vision des croyances anciennes, bien que respectueuse, reste fondamentalement académique. Il conçoit aisément l’existence historique des dieux païens – ces divinités romaines, grecques ou orientales dont les noms ornent les manuels d’histoire – mais ces entités demeurent pour lui des constructions culturelles, des projections symboliques de l’esprit humain. Il ne peut concevoir ce que j’entends réellement par “arts noirs”, car cela implique d’accepter l’existence d’un ordre cosmique qui transcende et défie notre compréhension humaine.

Le nom même de “Yog-Sothoth”, que j’ai prononcé dans mon incantation, lui est totalement étranger, n’appartenant à aucun panthéon recensé par l’anthropologie classique. Je m’efforce de lui faire comprendre que les arts auxquels je fais référence ne sont pas ce que le vulgaire nomme “magie noire” – ce folklore de pactes démoniaques et de sorcellerie médiévale qui alimente l’imaginaire populaire. Je parle de savoirs qui précèdent l’humanité elle-même, de pratiques liées à des entités cosmiques dont la nature même est inconcevable pour notre esprit limité.
“Yog-Sothoth” n’est pas un démon, ni même un dieu au sens conventionnel du terme. C’est une force primordiale, une entité cosmique qui existe simultanément en tous lieux et en tous temps – “le tout en un et un en tout”, comme le décrivent les textes anciens. Face à de telles puissances, notre humanité n’est qu’un détail insignifiant, une note dissonante dans une symphonie cosmique dont nous ne percevons que quelques échos déformés.
Au terme d’une discussion aussi longue qu’éprouvante, Eugène finit par admettre que les phénomènes dont nous avons été témoins ces derniers jours dépassent effectivement le cadre explicatif de son approche académique. L’occultisme traditionnel, avec ses rituels codifiés et ses symbolismes élaborés, ne suffit pas à rendre compte de la transformation hideuse de Matthew Pook ou de l’apparition spectrale qui a envahi notre compartiment. Face à l’évidence, même l’esprit le plus rationnel doit s’incliner.
“Nous avons soulevé une infime partie du voile de la réalité,” lui dis-je, “et ce simple aperçu a suffi à nous causer tous ces tourments.” Cette formulation semble le frapper plus que mes explications précédentes. Il hoche lentement la tête, comme si cette image du voile soulevé résonnait profondément avec sa propre expérience des jours passés.
Sa curiosité naturelle reprend cependant rapidement le dessus, et il me pose alors une question aussi directe qu’embarrassante : comment ai-je acquis ces connaissances ésotériques qui semblent si éloignées de ma formation de journaliste ? D’où me vient cette familiarité avec des entités et des pratiques dont l’existence même est ignorée par la majorité des occultistes ?
Face à cette interrogation légitime, je refuse de mentir à mes compagnons d’infortune. Ma loyauté envers eux m’interdit tout subterfuge, même si la vérité complète me semble encore trop lourde à partager. J’évoque donc, à demi-mots, les archives familiales et le journal de mon ancêtre, le soldat Beaumain.
Je leur explique que mon aïeul s’est déjà trouvé confronté à ces mêmes puissances obscures, dans un contexte historique différent. Sans entrer dans les détails qui pourraient sembler trop fantastiques, je mentionne que le nom de “Yog-Sothoth” apparaît dans ses écrits, liés à des événements troublants survenus pendant la Révolution française. Je leur en livre suffisamment pour établir la crédibilité de mes affirmations, mais je garde délibérément pour moi certains aspects plus personnels de ces découvertes.
En évoquant ainsi la lignée qui me relie à ces mystères anciens, je ressens une étrange communion avec mon ancêtre, comme si son esprit m’accompagnait dans cette épreuve. Ce n’est pas encore le poids écrasant d’un destin prédéterminé qui pèserait sur mes épaules, mais plutôt une forme de synergie transcendant les siècles, une force vitale qui circule à travers les générations de ma famille. Je ne suis plus seul face à l’incommensurable – mes ancêtres m’ont précédé sur ce chemin périlleux, et leur exemple nourrit ma détermination.
Ce que je tais délibérément, c’est la troublante coïncidence que j’ai découverte au fil de mes lectures. Dans le récit de mon ancêtre figurent des personnages dont les noms résonnent étrangement avec notre situation présente : un certain Pressi et un Hugel qui s’est révélé être une femme déguisée en homme. La similitude avec les patronymes d’Eugène Pressi et d’Églantine Hugel est trop frappante pour être attribuée au simple hasard. Ce fil supplémentaire dans la trame du destin qui semble se tisser autour de nous m’intrigue et m’inquiète à parts égales, mais je juge préférable de garder cette information pour moi, du moins pour l’instant.
Je redoute particulièrement l’effet que cette révélation pourrait avoir sur ma relation avec Églantine. Comment réagirait-elle en apprenant que son ancêtre a peut-être combattu aux côtés du mien, face à ces mêmes forces obscures que nous affrontons aujourd’hui ? Verrait-elle dans cette connexion ancestrale un signe du destin, ou la trouverait-elle aussi troublante que moi ? Dans le doute, je préfère me concentrer sur les défis immédiats qui nous attendent.

À l’issue de nos discussions, une certitude s’impose à nous tous : le livre intitulé “Les Murmures du Fez” constitue un élément indispensable dans notre quête. Sans ce grimoire, que Menkaph semble avoir en sa possession, nous n’avons aucun espoir de maîtriser l’artefact maudit et encore moins de le détruire. Ce livre représente notre unique voie de salut face à la menace que constitue le Fez.
Notre stratégie semble donc claire : nous devons récupérer ce livre et l’apporter au professeur Demir à Constantinople. Lui seul possède les connaissances nécessaires pour déchiffrer son contenu et nous guider dans son utilisation. Mais cette entreprise, dont la nécessité s’impose à notre raison, nous apparaît simultanément d’une témérité confondante.
Attaquer de front un occultiste de la puissance de Menkaph, entouré de ses acolytes et manifestement capable de manipuler des forces qui dépassent notre entendement, semble proprement suicidaire. Et pourtant, avons-nous réellement le choix ? Si Menkaph parvient à s’emparer de notre Fez, nous sommes condamnés. Mais si nous ne récupérons pas le livre, notre sort ne sera guère plus enviable.
Toute la question réside dans le timing de notre action. Une intervention trop précoce laisserait à Menkaph le temps de se venger, de récupérer son bien et peut-être même de s’emparer du Fez que nous transportons. Je suggère qu’il est urgent de renforcer les protections autour de notre artefact, tout en préparant minutieusement notre offensive.
J’exprime également l’espoir que l’arrivée prochaine du Baron Von Hofler à Vienne pourra nous apporter une aide précieuse face à ce péril imminent. Cet aristocrate viennois, dont Smith nous a vanté l’érudition en matière d’occultisme, pourrait bien détenir des connaissances ou des ressources qui nous font cruellement défaut.
Notre conciliabule stratégique est interrompu par l’arrivée du train en gare de Munich. Cette pause dans notre voyage m’offre l’occasion d’envoyer un télégramme à Julius Smith, l’informant de notre situation. Bien que je n’attende pas véritablement d’aide concrète de sa part, il me semble important de le tenir au courant des développements récents :
“JULIUS STOP VOYAGE DIFFICILE STOP BURNHAM ET MENKAPH DANS LE TRAIN STOP FEZ EN DANGER STOP AURIEZ VOUS DES INFOS SUR LE JOURNALISTE BURNHAM STOP EN ATTENTE DU BARON VON HOFLER POUR AIDE STOP ON S’ATTEND ENCORE À UNE NUIT AGITÉE STOP SIGNÉ PATRICE BEAUMAIN”

De retour à bord, j’observe depuis la fenêtre de ma cabine deux scènes qui attirent mon attention. La première implique Eugène, qui semble essuyer un rejet particulièrement cinglant de la part des aristocrates russes avec lesquels il avait tant cherché à se lier. Leur ostracisme manifeste confine à la cruauté, traduisant une volonté délibérée non seulement de l’éviter, mais de lui signifier publiquement son indésirabilité dans leur cercle. Cette humiliation sociale, bien que mineure au regard des dangers cosmiques qui nous menacent, n’en demeure pas moins douloureuse pour notre compagnon.
La seconde scène, bien plus prometteuse, me révèle une facette insoupçonnée d’Églantine. Avec un talent d’actrice que je ne lui connaissais pas, elle simule une détresse émotionnelle apparemment causée par la goujaterie d’Eugène – encore lui, décidément au centre de toutes les attentions aujourd’hui. Cette performance lui permet d’approcher une certaine Miss Mac Grégor, une journaliste dont la réputation d’indépendance et d’autonomie m’est vaguement familière.
Cette manœuvre habile me fait entrevoir une possibilité stratégique des plus intéressantes. Mac Grégor pourrait constituer un atout précieux dans notre entreprise, peut-être même une alliée potentielle. Son statut de journaliste pourrait lui donner accès à des informations cruciales pour nos projets futurs, et son indépendance d’esprit suggère qu’elle serait moins susceptible de succomber aux charmes trompeurs ou aux intimidations de Menkaph.
Plus spécifiquement, je me prends à imaginer qu’elle pourrait nous aider à établir un contact avec la jeune femme mélancolique qui accompagne la suite turque. Cette approche indirecte, par l’intermédiaire d’une tierce personne apparemment neutre, nous offrirait peut-être un point d’entrée dans le cercle fermé de Menkaph, une source d’informations précieuses sur ses intentions et ses méthodes.
J’observe avec curiosité l’échange entre Églantine et Mac Grégor, qui semble se dérouler de manière tout à fait cordiale. La facilité avec laquelle Églantine parvient à établir ce contact m’impressionne, confirmant une fois de plus la finesse psychologique et les talents sociaux de cette femme décidément remarquable à bien des égards.
Le train s’ébranle à nouveau, poursuivant sa course inexorable vers l’Est. À mesure que nous nous rapprochons de Constantinople, je sens confusément que nous approchons également du dénouement de cette aventure extraordinaire. Que ce dénouement doive être favorable ou funeste, je l’ignore encore, mais une certitude s’impose à moi : rien ne sera plus jamais comme avant pour ceux d’entre nous qui survivront à cette confrontation avec l’inconcevable.




