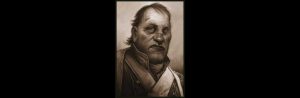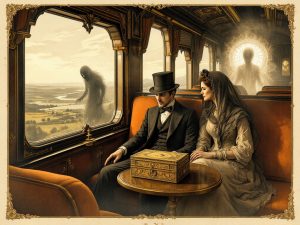- Assemblée Nationale
Établie “Assemblée Nationale Constituante” entre le 17 juin 1789 et le 20 juin 1789 (Serment du Jeu de Paume).
À partir du 1er octobre 1791 elle est réformée et devient l’Assemblée nationale législative — première représentation nationale française de « type moderne ». Le Corps législatif a la charge de mettre en œuvre cette Constitution dans une société qui, loin de se trouver dans une situation stabilisée, est en pleine mutation.
Elle se réunit dans la salle du Manège du jardin des Tuileries.
Tous les élus sont nouveaux, une disposition ayant rendu inéligibles à la première législative les députés sortant de la Constituante.
Cela prendra fin avec l’établissement de la Convention Nationale en septembre 1792.
- Calendrier Révolutionnaire Républicain
Le calendrier républicain est institué par la Convention nationale le 23 octobre 1793.
L’An I, le début de la nouvelle ère, est fixé à l’équinoxe de l’automne précédent, le 22 septembre 1792, jour de la proclamation de la République, qui devient ainsi le 1er vendémiaire an I.
Comme le système métrique, mis en chantier dès 1790, ce calendrier marque la volonté des révolutionnaires d’adopter en remplacement du calendrier grégorien un système universel s’appuyant sur le système décimal, qui ne soit plus lié à la monarchie ni au christianisme. Outre le changement d’ère (renumérotation des années), il comprend un nouveau découpage de l’année, et de nouveaux noms pour les mois et les jours.
Mois d’automne
Vendémiaire (22/23/24 septembre ~ 21/22/23 octobre) – Période des vendanges
Brumaire (22/23/24 octobre ~ 20/21/22 novembre) – Période des brumes et des brouillards
Frimaire (21/22/23 novembre ~ 20/21/22 décembre) – Période des froids (frimas)
Mois d’hiver (terminaison en -ôse)
Nivôse (21/22/23 décembre ~ 19/20/21 janvier) – Période de la neige
Pluviôse (20/21/22 janvier ~ 18/19/20 février) – Période des pluies
Ventôse (19/20/21 février ~ 20/21 mars) – Période des vents
Mois du printemps (terminaison en -al)
Germinal (21/22 mars ~ 19/20 avril) – Période de la germination
Floréal (20/21 avril ~ 19/20 mai) – Période de l’épanouissement des fleurs
Prairial (20/21 mai ~ 18/19 juin) – Période des récoltes des prairies
Mois d’été (terminaison en -idor)
Messidor (19/20 juin ~ 18/19 juillet) – Période des moissons
Thermidor (19/20 juillet ~ 17/18 août) – Période des chaleurs
Fructidor (18/19 août ~ 16/17 septembre) – Période des fruits
- Commune de Paris
C’est le gouvernement révolutionnaire de Paris. Il est établi après la prise de la Bastille le 14 juillet 1789.
Le 20 juillet, chaque district de Paris élit deux représentants, formant une assemblée municipale de 120 élus. Cette assemblée est alors à l’image des députés du tiers état, majoritairement formée de bourgeois aisés, de juristes, de marchands et de négociants, de médecins, avec aussi quelques artisans et nobles. Du 25 juillet au 8 octobre 1789, se constitue une Assemblée générale des représentants de la Commune provisoire et le 8 octobre 1789, une Assemblée générale des représentants de la Commune définitive.
Par la loi du 21 mai 1790, le gouvernement révolutionnaire devient un organisme régulier, le Comité général de la Commune de Paris, dont les membres sont élus par les citoyens actifs dans les 48 sections révolutionnaires de la ville. Ce comité a à sa tête un corps municipal dont le maire et seize administrateurs assurent la direction, tandis qu’un procureur-syndic et ses substituts ont en charge les intérêts des administrés4.
À partir du 10 août 1792 elle devient “Commune Insurrectionnelle”. La Commune défend alors les idées des sans-culottes parisiens et constitue un des organes principaux du pouvoir révolutionnaire.
- Convention nationale
La Convention nationale est une assemblée constituante élue en septembre 1792, au cours de la Révolution française, à la suite de la chute de Louis XVI le 10 août 1792 et de l’échec de la monarchie constitutionnelle.
Cette assemblée, qui succède à l’Assemblée législative, est élue pour la première fois en France au suffrage universel masculin, et est destinée à élaborer une nouvelle constitution.
Elle reste en place du 22 septembre 1792, date de la proclamation de la République, au 26 octobre 1795, date de la promulgation de la constitution de l’an III, qui met en place le régime du Directoire.
- Cordeliers
Le Club des cordeliers ou société des Amis des droits de l’homme et du citoyen est une société politique fondée le 27 avril 1790 et sise dans l’ancien réfectoire du couvent des Cordeliers de Paris.
Après la chute des girondins, le club se divisa entre indulgents (les dantonistes) et exagérés (les hébertistes, auteurs de la loi des suspects et partisans d’une dictature de la Commune – à ne pas confondre avec les « enragés » de Jacques Roux, exclus des Cordeliers le 30 juin 1793). Les hébertistes joueront un rôle prépondérant et deviendront après avoir contribué à éliminer les Enragés du jeu politique, les porte-parole des revendications sociales les plus avancées.
- Girondins
Les Girondins sont influents à l’Assemblée législative. Ils ont des ministres dans le gouvernement de Louis XVI et soutiennent notamment l’entrée en guerre de la France contre l’Autriche en avril 1792, voulue pour affermir la Révolution. Ils souhaitent épargner le roi déchu, et leur électorat est essentiellement provincial.
Ils siègent à droite dans la salle de l’Assemblée Nationale.
- Hébertistes
Les hébertistes, appelés les « exagérés », sont sous la Législative et la Convention principalement des membres du club des Cordeliers, appartenant pour un grand nombre aux rangs de la Montagne à la Convention, à l’administration de la Commune et du Département de Paris.
- Jacobins
La société des Amis de la Constitution, plus connue ensuite sous le nom de Club des jacobins, est le plus célèbre des clubs révolutionnaires de la Révolution française. Ses membres sont établis dans l’ancien couvent des Jacobins à Paris.
Le Club des jacobins forme une société de pensée qui a constitué, pendant la Révolution française, à la fois un groupe de pression et un réseau d’une remarquable efficacité. L’action du club, essentielle dès le début de 1790, devient dominante entre 1792 et 1794. À la fin de 1793, environ 6 000 sociétés de même type sont en correspondance avec lui dans toute la France. La chute de Robespierre marque la fin du grand rôle politique exercé par le club et entraîne sa dissolution en novembre 1794.
Depuis cette époque, le nom et l’adjectif s’appliquent à un homme, une femme ou un courant politique partisan d’un pouvoir centralisé de l’État et hostile à toute idée de son affaiblissement ou de son démembrement.
Le jacobinisme est un concept qui renvoie à des principes politiques défendus pendant la Révolution française, tels la liberté et l’égalité, ou encore la souveraineté populaire, puis, plus tardivement, l’unité et l’indivisibilité de la République française.
Le mot “jacobinisme” tient son nom du club des Jacobins, dont les membres s’étaient établis pendant la Révolution française dans l’ancien couvent des Jacobins à Paris.
- Montagnards
Les Montagnards forment un groupe politique composé des révolutionnaires les plus radicaux. Ils sont incarnés par les figures de Robespierre, Danton ou Marat — que ce soit au Club des jacobins dont la plupart sont membres, à l’Assemblée législative ou à la Convention. Ils désirent la mort de Louis XVI et sont principalement soutenus par les parisiens.
Ils siègent à gauche dans la salle de l’Assemblée Nationale.
- Sans-culottes
« Sans-culottes » est le nom donné, au début de la Révolution française de 1789, aux manifestants populaires qui portent des pantalons à rayures et non des culottes (hauts-de-chausses), symbole vestimentaire de l’aristocratie d’Ancien Régime.
Les sans-culottes sont des révolutionnaires issus du petit peuple de la ville et défenseurs d’une République égalitaire. Ils sont jugés par les autres révolutionnaires comme radicaux car ils prônent la démocratie directe, sans intermédiaires comme les députés.
Ils se distinguent par leurs modes d’expression, en particulier vestimentaires. Leur tenue comporte généralement un pantalon à rayures bleues et blanches, au lieu de la culotte courte et des bas, portés par les nobles et les bourgeois, ainsi qu’un bonnet phrygien rouge, et une tendance à la simplicité.
Ce costume est un signe de protestation, arboré par des avocats, des commerçants, des employés, des artisans, des bourgeois, puis par les membres de toutes les conditions qui se présentaient comme « patriotes ».