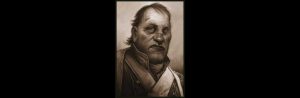Le crépuscule tombe lentement sur Paris en cette soirée historique du 14 juillet 1789. Les derniers rayons de soleil effleurent les pavés, dessinant de longues ombres à travers la place de la Bastille, désormais encombrée de débris et d’armes abandonnées. Le fort bruissement des conversations et des éclats de voix ponctués de rires emplit l’air, contrastant avec les regards inquiets échangés dans la troupe. Une décision importante plane au-dessus de leur groupe : se débarrasser ou non de leurs uniformes, symboles de leur statut militaire, mais également d’une identité chèrement acquise à travers les campagnes passées. Pour Beaumain, il est impensable de jeter ce qui représente son honneur et sa fidélité ; il décide de les garder dans un grand sac qu’il porte sur son dos.
En cette heure où la lumière vacille, Dupois, fidèle à ses habitudes, se faufile discrètement pour dégoter quelques bouteilles de vin rescapées des caves de la Bastille. Le groupe trinque à leur victoire qui n’a pas eu besoin de feu et de sang ; une certaine fierté les habite tous, eux qui, en cette journée, ont choisi de ne pas lever leurs armes contre leurs frères.
Ils décident finalement de se diriger vers l’appartement de l’imprimeur, rue d’Orléans. Dans la foule, des chants révolutionnaires fusent, des bras s’enlacent et des voix scandent la fin de l’oppression. Des enfants courent entre les jambes des adultes, leurs rires insouciants vibrant au rythme des tambours de fortune. Pourtant, derrière chaque sourire se cache une vigilance tenace : ce soir, tout peut basculer. Paris est en liesse, certes, mais les murs de pierre retiennent encore les murmures de ceux qui craignent une répression imminente.
Alors qu’ils avancent, ils se mêlent aux différents visages de cette révolution naissante : artisans et boutiquiers, miséreux vêtus de haillons, bourgeois en gilets élégants, tous animés par la même fièvre, la même euphorie. Les torches illuminent les façades, donnant aux bâtiments une allure spectrale. À chaque coin de rue, la troupe capte des bribes de conversations, des promesses d’un avenir meilleur, mais aussi des avertissements chuchotés sur l’incertitude de demain.
Arrivés à l’appartement, ils poussent la porte de cette tanière désormais silencieuse. Les meubles sont couverts de poussière, les papiers dispersés témoignent des journées de travail passées par l’imprimeur pour dénoncer les abus. Dans cette demeure qui porte encore l’empreinte de son ancien occupant, ils trouvent un peu de répit, profitant de la nourriture glanée en chemin et des précieuses bouteilles de vin. La nuit, pourtant paisible, n’en demeure pas moins lourde d’incertitudes : demain, que restera-t-il de cette victoire ?
Dans l’atmosphère feutrée de l’appartement, la troupe, encore haletante de cette journée de révolte, s’installe en cercle, éreintée mais le regard vif. La lumière vacillante des chandelles souligne la gravité des visages, et une question brûle sur toutes les lèvres : et maintenant, que feront-ils ? Quelle voie suivre dans ce Paris en ébullition, déchiré entre les élans de liberté et la fidélité à la monarchie ?
Le sergent Renault, droit comme un i, prend la parole en premier :« Nous devons retourner à Versailles, les gars, c’est là qu’est notre devoir. On est des soldats du roi, des hommes de foi, et c’est le capitaine Malon qui nous a menés ! Notre loyauté est claire : vers le Roi, le véritable représentant de l’ordre divin. »
Un silence pesant tombe, bientôt rompu par un éclat de rire amer de Hugel. Sa main tremble d’indignation. « Divin, dis-tu, Sergent ? L’ordre divin serait donc la misère que nous voyons chaque jour ? La famine qui gronde à nos portes ? Je te demande, sergent : où est Dieu dans tout ça ? Tu penses vraiment que notre roi, en jouant des coudes à Versailles avec sa catin autrichienne, nous porte sur son cœur ? Moi, je dis que ce tyran mérite la chute que le peuple lui réserve ! » À ces mots, Hugel laisse échapper un ricanement dédaigneux et, sans un regard pour le sergent, il crache bruyamment au sol.
Renault, la mâchoire crispée, lance un regard tranchant à Hugel. « Parle avec un peu plus de respect, Hugel ! C’est grâce à ce ‘tyran’, comme tu dis, qu’on a pu gagner nos batailles, qu’on n’a pas vécu sous le joug de l’ennemi ! Le roi incarne l’unité, l’âme de cette France. Ce roi nous a guidés et protégés. Sans lui, c’est le chaos ! »
Hugel, une lueur sauvage dans les yeux, se redresse, sa voix remplie de fiel : « Protéger ? Dis plutôt qu’il nous tient en laisse, nous et tout un peuple ! Et pendant que nous, on saigne pour sa couronne, lui festoie, se prélassant dans ses palais dorés. C’est ça, l’ordre divin ? Où est Dieu là-dedans, Sergent ? Le peuple n’a pas besoin de cet ordre-là. »
Le sergent hésite, mais Beaumain, jusque-là resté en retrait, prend la parole d’une voix ferme : « Hugel a raison de poser cette question, sergent. Aujourd’hui, on a désobéi, tous, en refusant de tirer sur le peuple. Et c’est toi, Sergent, qui a demandé au gouverneur Delaunay de discuter avec eux, de capituler pour éviter un massacre. Où sont les ordres royaux là-dedans ? »
Renaut détourne le regard, visiblement troublé, et Beaumain poursuit, accentuant chaque mot avec un calme implacable : « Sergent, nous avons retiré nos uniformes. Pour la première fois, tu as permis à un gouverneur de renoncer à ses fonctions de soldat. Ce n’est pas un geste loyal envers notre roi. Tu as vu comme nous la misère, la faim, et ce peuple qui n’a plus que la révolte comme recours. Est-ce vraiment notre place, là-bas, dans les dorures de Versailles, à protéger ceux qui méprisent le peuple ? A protéger ceux qui envoient des ordres de mort ? Ces ordres que nous avons refusés d’exécuter aujourd’hui, toi et moi ? »
La pique atteint sa cible, et Renault baisse les yeux un instant, comme pour chercher ses mots. Mais Dupois intervient d’une voix bourrue, presque hargneuse : « Beaumain, tu parles comme un pamphlet de rue ! Bon sang, moi, je suis soldat, point. On m’a appris à suivre le roi, et c’est ce que je compte faire. Si vous voulez vous retrouver à marcher à la botte de ces bourgeois de la garde nationale, c’est votre choix, mais moi, je ne me laisse pas embobiner par des idéaux à deux sous. »
Renaut serre les poings et murmure : « Ce n’est pas à nous de juger les décisions de notre roi. L’ordre vient de lui, il est l’incarnation de la France ! Sans lui, c’est le chaos. »
Hugel, un sourire amer au coin des lèvres, siffle un autre crachat au sol, éclaboussant le bois usé de la table. « Le chaos, hein ? Et tu crois que ce chaos, ce n’est pas déjà ce qu’on vit ? Regarde autour de toi ! Nous sommes dans un appartement d’imprimeur, celui qui fait ces ‘rééditions’, dit-il en levant une brochure – ou devrais-je dire ‘redditions’, comme celles qu’on demande aux gouverneurs et aux sergents aujourd’hui ! »
Quelques rires nerveux fusent, la tension se brisant un instant dans cette ironie. Mais l’atmosphère s’alourdit à nouveau, chaque regard fixant Renaut, le silence comme un poids autour de lui.
Beaumain, inspiré par l’éclat de Hugel, reprend plus doucement : « Aujourd’hui, j’ai vu un peuple se gouverner lui-même pour la première fois. Est-ce vraiment une trahison, sergent, que d’aider le peuple à se libérer ? Peut-on, en tant qu’homme, continuer de servir un ordre que nous savons injuste, immoral ? Est-il juste, est-il divin, d’exécuter aveuglément ces ordres royaux inhumains ? »
Pressi, qui jusqu’ici n’a rien dit, enchaîne à son tour, les yeux pétillants de cette lueur de défi : « Sergent, ce que tu ne vois pas, c’est que les temps changent. Le roi, la noblesse, tout ça va disparaître, que tu le veuilles ou non. Peut-être que notre place est ici, avec ceux qui veulent bâtir quelque chose de nouveau, loin de ces palais qui nous écrasent. La garde nationale, elle, sait qu’elle doit protéger le peuple. Si tu refuses de voir la réalité, tu finiras par être balayé, comme tous ceux qui ignorent le changement. »
Renault, reprenant son souffle, frappe du poing sur la table : « Tu parles de la réalité, Pressi ? La réalité, c’est que la France est construite sur le droit divin. C’est ainsi que le monde doit marcher ! Vous préférez donc vous laisser manipuler par cette ‘liberté’ qu’on nous vend ? La liberté de crever de faim, de voir des pères perdre leurs enfants à cause de la violence qui gangrène notre pays ? On est des soldats. On a juré fidélité au roi, et je compte bien honorer mon serment. »
Hugel, furieux, l’interrompt : « Ton serment, sergent, n’a plus de valeur quand il est fait à un homme qui oublie les siens. Je me bats pour un pays où on ne mourra pas sous le joug d’une noblesse qui festoie pendant que nous, pauvres diables, sommes ceux qui payent le prix fort. Le peuple a besoin de nous, et moi, c’est pour eux que je veux rester. » Le sol se couvrant d’un crachat de plus.
Babin, jusque-là silencieux, soupire en regardant toute la troupe tour à tour. « Pourquoi se déchirer ainsi ? Le peuple, le roi… c’est toujours le même refrain. Et si on attendait de voir où tout ça nous mène ? La France, c’est elle que nous devons protéger. Ni seulement le peuple, ni uniquement le roi. Peut-être qu’on devrait attendre, voir comment les choses vont évoluer. Nous n’avons pas tous les éléments pour faire le bon choix »
Renaut baisse la tête, visiblement troublé, et dans un murmure, presque pour lui-même, lâche : « Et si vous avez tort… si, sans nous, c’est le chaos qui triomphe ? Nous avons vu des révoltes, des émeutes, nous savons comment tout cela finit… On se retrouvera bientôt entre deux feux, à devoir choisir : soit la loi, soit la révolution. Et le roi, lui, ne pardonnera pas. »
Un autre crachat de Hugel marque le sol de son mépris, une révolte silencieuse et acide qui fait grincer Renaut. Les regards s’échangent, chacun remettant en question ses convictions, sa loyauté, sa raison d’être. Un silence tendu s’installe. Finalement, Pressi s’éclaircit la gorge, la voix calme : « Alors, pourquoi ne pas aller voir la garde nationale. Pour comprendre. Peut-être que c’est là que notre place est, pour ne plus servir aveuglément. »
Les murmures s’élèvent, chacun dans la troupe semblant plongé dans ses pensées. Le débat semble sans fin, les avis de chacun ancrés dans des convictions inébranlables. Un coup sec à la porte rompt soudain le silence ; une voix de femme, familière et tonitruante, traverse l’épaisseur de la porte : « Dupois, tu te caches donc ici ?! Bande de lâcheurs ! Vous ferez bien mieux de venir festoyer avec nous aux portes de Paris ! »
Dupois sourit, la dureté de son expression s’adoucissant, et il échange un regard avec ses compagnons. « Bon, les gars, après toute cette discussion, j’dis qu’on peut bien aller se dégourdir un peu. Rien de tel qu’un verre pour éclaircir les idées. » Un éclat de rire résonne, et, finalement, la tension se dissipe, chacun ébranlé par la profondeur de la discussion mais aussi par la force des liens fraternels qui les unissent.
La pièce est baignée d’une lumière douce, le jour venant à peine de se lever, et pourtant la troupe est déjà rassemblée, accoudée autour de cette table usée, chacun semblant scruter l’horizon de ses pensées. Le poids des décisions qui flottent dans l’air est allégé par l’amitié sincère et la fraternité que les combats ont forgé. Beaumain, le premier, rompt le silence, sa voix calme mais assurée.
« Mes amis, hier… on a vu le peuple se lever, et pour la première fois, j’ai senti que c’était là ma place. Je ne peux plus continuer comme avant, à suivre des ordres qui piétinent notre peuple. Je vais suivre mon cœur et offrir mon expérience à la garde nationale. Ils auront besoin de nous pour les guider, les protéger. Peut-être que je me fais des idées, peut-être que c’est fou d’espérer… mais je crois en ce rêve d’un peuple gouverné par le peuple. » Beaumain se redresse, et dans son regard brille une flamme de conviction presque sereine. « C’est le moment, les gars. On a toujours rêvé d’une France meilleure, et maintenant, elle est là, devant nous. »
Renaut, le sergent, l’écoute, le visage marqué de fatigue et d’hésitations. Il soupire, son regard se perdant dans le vide. « Beaumain, tu parles d’un idéal… d’un rêve. Mais on est des soldats du roi, c’est lui qui nous a fait hommes. En se joignant à cette révolution, on abandonne tout ce qu’on a juré. Et pourtant… » Il hésite, ses mots trahissant une fissure dans ses certitudes. « Je n’aurais jamais cru voir le peuple tenir tête au roi et réussir. Cette force, cette unité… C’est vrai qu’elle fait réfléchir. »
Hugel, qui trépigne d’impatience, lance avec un sourire éclatant : « Ce peuple, c’est moi, c’est nous tous ! Ça ne se discute même pas. On peut servir un roi, ou on peut servir nos frères et sœurs qui crient pour leur liberté. Le peuple c’est nous ! »
Les paroles de Hugel s’immiscent comme un souffle vivifiant. Pressi, de son côté, hoche la tête, la voix calme mais teintée d’une gravité douce : « Hugel a raison. Hier, quand j’ai vu cette foule, j’ai ressenti cette même chaleur… Ce n’est plus un rêve, Beaumain. C’est déjà une réalité qui prend forme. Je suis prêt à offrir mon épée à cette cause. Ensemble, on peut aider ce peuple à s’élever, à faire naître une France où chacun aura sa place. »
Les yeux de Renaut vacillent un instant, et un sourire las éclaire son visage. « Vous êtes prêts à aller jusqu’au bout, hein ? » Il fixe Beaumain, qui garde son regard droit et intense. « Très bien, je ne vous abandonnerai pas. On a partagé trop de choses pour que je vous laisse partir seuls dans cette folie. Je vous suivrai, même si… je ne crois pas que ce soit la meilleure solution. » Une lueur de doute persiste dans ses yeux, mais la fraternité qui l’unit à ces hommes le pousse à leur côté.
Dupois, silencieux jusqu’à présent, hoche la tête, la voix plus bourrue que jamais. « J’ai jamais été bon pour les discours. Mais si mon sergent va là-bas, alors j’y vais aussi. J’suis soldat, et mes frères d’armes sont tout ce qui m’importe. Mais, » il marque une pause, visiblement ému, « abandonner le roi… eh bien, ça coûte. »
Le silence s’installe quelques instants, chacun respectant le conflit intime de Dupois. Finalement, c’est Babin qui prend la parole d’une voix douce, presque timide : « J’aurais préféré attendre… voir de quel côté souffle le vent. Mais… que je sois fou, je ne veux pas rester derrière. Sans vous, je me sentirais comme un étranger. On a toujours été ensemble, et pour moi, c’est tout ce qui compte. Peu importe le roi ou la révolution, tant qu’on est unis. »
À ces mots, un sourire éclaire les visages fatigués. La décision, bien qu’incertaine et chargée d’interrogations, semble les apaiser. Ils se regardent tour à tour, un lien invisible et puissant les unissant. Pour un moment, les doutes et les idéaux passent au second plan. C’est la fraternité qui les pousse, celle qui les a unis sur tous les champs de bataille et qui aujourd’hui, malgré l’histoire et les idéologies qui vacillent autour d’eux, les maintient ensemble.
Beaumain, la voix plus douce, les regarde avec un sourire franc. « Nous n’abandonnerons personne. Ce sera dur, peut-être plus dur que tout ce qu’on a vécu. Mais tant qu’on est ensemble, je sais qu’on y arrivera. »
Un murmure d’approbation passe dans les rangs, et dans cette décision commune, chacun trouve une paix inattendue. C’est le début d’un nouveau combat, cette fois pour un idéal plus vaste que leur uniforme, et chacun, au fond, sait qu’il ne pourrait le mener qu’avec ceux qu’il considère comme ses frères.
Sous un ciel d’un bleu pâle, à peine troublé par quelques nuages légers, la troupe s’aventure dans un Paris encore en ébullition. Les rues sont pleines de traces des combats de la veille : des pavés manquants, des débris épars, et ici et là, quelques pans de murs noircis par les feux de la révolte. Partout autour d’eux, les visages portent des regards à la fois fiers et inquiets, comme s’ils réalisaient seulement la portée de ce qu’ils avaient accompli. Chaque ruelle semble recéler des murmures, des éclats de voix enflammées, des discussions animées sur l’avenir.
Leur marche est ralentie par la foule qui envahit les rues, des habitants curieux, des hommes et femmes exaltés brandissant fièrement des cocardes tricolores. Il est difficile d’avancer, et Beaumain et ses camarades doivent jouer des coudes pour se frayer un passage. Un marché improvisé semble s’être installé sur un coin de place, avec des femmes vendant des rubans aux couleurs de la liberté et des pamphlets à peine imprimés dénonçant les abus royaux. La scène déborde d’énergie, un chaos à la fois exaltant et accablant.
Après de longs détours et des haltes forcées, ils parviennent enfin du côté du jardin du Luxembourg, où on leur a dit qu’un semblant de quartier général de la garde nationale s’est installé. Le « QG » improvisé se révèle en fait être un amoncellement de tentes dépareillées autour d’un grand bâtiment et de petites barricades autour desquelles traînent quelques hommes aux uniformes hétéroclites. Deux soldats barrent l’entrée du bâtiment. En uniforme dépenaillé, des boutons manquants et des symboles arrachés, ils portent maladroitement des mousquets qu’ils semblent à peine savoir manier. À la place des insignes royaux, une cocarde tricolore est épinglée en guise de symbole de la nouvelle ère. Leur posture hésitante montre qu’ils ne sont pas des soldats aguerris, loin de là.
Le sergent Renaut, fort de son expérience, ne se laisse pas impressionner. Il s’approche d’eux avec l’assurance d’un homme habitué à faire valoir son rang. « Vous allez nous laisser passer, nous venons offrir notre expérience à la garde nationale. » Sa voix ferme, légèrement condescendante, force les deux hommes à s’écarter rapidement, visiblement nerveux devant le groupe d’anciens soldats qui affiche une résolution palpable.
À l’intérieur du bâtiment qui fait office de bureau de réception, ils sont accueillis par un homme de petite taille, à l’air maigrichon et nerveux, le regard fuyant et une attitude légèrement arrogante. Son visage rappelle celui d’une fouine, vif et rusé, et son sourire narquois semble souligner une certaine supériorité mal dissimulée.
Beaumain, d’un pas décidé, prend les devants et s’adresse à l’homme. « Nous sommes des soldats, du peuple. Nous avons refusé de tirer hier, et nous souhaitons intégrer la garde nationale pour servir la France libre, non pas un roi tyrannique. Nous avons l’expérience des armes, de la discipline. C’est notre place. » Mais la fouine ne répond pas tout de suite, le regardant de haut avec une expression mi-amusée, mi-dédaigneuse, ses doigts tambourinant nerveusement sur la table.
Le silence s’éternise, et la tension monte dans les rangs de la troupe, qui échange des regards impatients. Beaumain reprend, plus insistant : « On veut mettre notre savoir-faire à votre service. On a refusé de tirer, parce qu’on fait partie de ce peuple. On y croit. Et on est prêts à prêter serment pour défendre Paris contre toute tyrannie. »
La petite fouine hausse un sourcil, comme si elle ne comprenait toujours pas ou peut-être qu’elle refuse d’admettre la sincérité de Beaumain. « Ah, vraiment ? Vous dites être ‘du peuple’ et ‘contre la tyrannie’… » Il ponctue ses mots d’un sourire désabusé, « mais les autres, ici, les braves gens de Paris, ne voient en vous que des soldats royaux de plus. Vous leur direz que vous avez refusé de tirer, et ils vous croiront ? Je ne suis pas certain que ce soit si simple. »
Pressi, un peu en retrait, glisse à voix basse à ses camarades : « Ce type se prend pour un grand chef, mais il est visiblement dépassé par les événements. » Hugel, lui, croise les bras, son regard lancé à l’homme révélant un mépris à peine dissimulé.
Beaumain, avec plus de fermeté, insiste : « Nous avons risqué notre vie pour désobéir aux ordres royaux. Hier encore, nous étions en uniforme, mais aujourd’hui, nous sommes ici pour offrir notre soutien. Nos compétences sont là, et il serait insensé de les refuser. »
L’homme, piqué par le ton de Beaumain, le regarde intensément, mais reste silencieux. Hugel, agacé par ce mépris latent, tousse bruyamment et crache par terre, un geste de défi qui en dit long sur son impatience. Renaut, de son côté, reste impassible, gardant un œil sur les réactions de la fouine.
Une porte s’ouvrit lentement, et un homme entra dans la pièce, silencieux mais imposant. Sa tenue impeccable — redingote taillée à la perfection, perruque poudrée sans le moindre défaut — semblait faite pour attirer le regard et imposer un respect presque instinctif. Son port altier et son regard perçant inspirèrent un instant de recul dans l’assemblée, et même la fouine, qui jusqu’ici s’agitait avec une certaine assurance, se fit discrète, rentrant instinctivement la tête dans ses épaules.
L’homme balaya la pièce de ses yeux sombres et scrutateurs, détaillant chaque soldat, comme s’il s’agissait de s’assurer de leur intégrité, ou peut-être de jauger leur loyauté. Lorsqu’il rencontra le regard de Beaumain, ce dernier soutint l’échange sans fléchir, bien que la tension dans l’air eût densifié la pièce.
« Alors, reprenons, messieurs, » déclara Beaumain, prenant l’initiative d’un ton solennel. « Nous avons choisi de rester aux côtés du peuple, de ne pas tourner nos armes contre lui, et nous demandons à être intégrés dans la Garde Nationale. Nous sommes des soldats, formés et aguerris, et nous offrons notre expérience pour servir cette cause nouvelle. »
L’homme plissa les yeux, comme pour mesurer la portée de chaque mot, et répliqua calmement, d’un ton tranchant : « Je vois… Vous parlez de loyauté envers le peuple, mais n’êtes-vous pas des soldats du roi, tenus par un serment d’allégeance ? Qu’est-ce qui vous convainc aujourd’hui de retourner cette allégeance ? »
« C’est justement parce que nous servons le peuple de France que nous avons refusé les ordres royaux, » répondit Beaumain, le regard fixe. « Nous avons vu trop de misère, trop de colère, pour ignorer ce qui est juste. Nous avons choisi le chemin de la vérité et de la justice pour notre patrie, qui n’appartient plus à la royauté seule, mais au peuple. »
Un silence s’installa, seulement brisé par la voix douce mais ferme d’Hugel, qui demanda d’un air intrigué, presque timide : « Pardonnez-moi, mais… qui êtes-vous pour douter de notre engagement ainsi ? »
L’homme inclina légèrement la tête vers lui, et un sourire presque imperceptible apparut sur ses lèvres. « Je suis Maximilien Robespierre, citoyen. »
L’impact de ces mots se répercuta en écho dans la pièce. Beaumain, loin de se laisser intimider, reprit pourtant, avec une détermination décuplée par la révélation : « Citoyen Robespierre, nous sommes venus vous montrer que nous ne craignons pas de prendre position. Notre expérience des champs de bataille et du maintien de l’ordre peut se mettre au service de la Garde Nationale. Il est de notre devoir de protéger cette révolution, de nous y engager pour la sauvegarde du peuple. »
Robespierre, sans même lever un sourcil, répondit, pesant chaque mot : « C’est justement là que le dilemme se pose, citoyen Beaumain. Car protéger la révolution exige bien plus qu’un bras armé et une expérience militaire. Il faut une loyauté infaillible, une foi en ce nouveau monde que nous sommes en train de bâtir. En êtes-vous vraiment capables, vous qui avez, jusqu’à hier, servi la royauté ? »
Beaumain se redressa, sa voix vibrante d’une passion contenue : « J’ai servi la royauté, oui. Mais j’ai toujours cru que notre mission était de protéger la France et son peuple. Aujourd’hui, ce peuple est en souffrance, et c’est à lui que je souhaite prêter main-forte, non à ceux qui l’oppressent. Nous avons refusé de tirer sur nos frères, et cela prouve notre loyauté envers cette cause. »
Robespierre le fixa intensément, comme s’il cherchait à sonder les tréfonds de son âme. « Et si demain la cause exige de vous des sacrifices, de renoncer à vos privilèges passés, de trancher dans vos convictions, serez-vous prêt à vous y plier ? »
Beaumain marqua une légère hésitation, mais ses traits restaient fermes. « Oui. Ce n’est pas par dépit que nous sommes ici, mais par conviction. »
Hugel, sentant le poids des mots et l’importance du moment, prit une légère inspiration et ajouta, un brin fébrile : « Nous sommes venus en toute sincérité, citoyen Robespierre. Nous avons vu ce qu’il se passe dans les rues, la colère, la faim… Ce n’est plus pour un roi que nous combattons, mais pour ceux qui ont besoin de nous. »
Dans le silence de la pièce, la voix de Robespierre s’éleva, tranchante et précise : « Y a-t-il des officiers parmi vous ? »
Un instant de flottement traversa la troupe. Le sergent Renaut, resté en retrait jusque-là, ne bougea pas, visiblement pris entre le poids de sa hiérarchie passée et les doutes sur son rôle en cette heure de rupture. Les yeux de Robespierre se posèrent sur lui, pénétrants, mais le silence de Renaut resta solide, implacable. Alors, dans un demi-sourire, Robespierre se tourna vers Beaumain.
« Sachez que je peux faire de vous un sergent, soldat Beaumain, si c’est ce que requiert votre loyauté pour cette nouvelle armée. »
Renaut se redressa d’un coup, comme réveillé par le signal d’une trompette militaire, et s’avança pour se placer face à Robespierre. D’un geste net, il se présenta, droit et impassible, avec cette rigidité qui trahissait tout autant son respect que l’émotion qui semblait vouloir percer. Robespierre marqua une pause, ses yeux sombres scrutant le sergent d’un regard aiguisé, presque amusé. Un léger sourire en coin apparut sur ses lèvres.
Robespierre inclina la tête vers Renaut et vers le reste de la troupe. « Nous sommes tous citoyens, désormais. Bourgeois, nobles ou sergents d’antan, les distinctions n’ont plus de place ici, » déclara-t-il, sa voix résonnant avec une autorité inébranlable.
Robespierre parla, avec une intensité qui frappa toute la pièce : « Je vais donc vous poser une dernière question, et répondez avec la même honnêteté. Êtes-vous prêts à mourir pour cette cause, et, si le besoin s’en fait sentir, à abandonner toute trace de votre passé ? »
Beaumain soutint son regard, immobile, et dans cette fraction de seconde, tous les sacrifices, tous les choix faits jusqu’ici semblaient peser sur ses épaules. « Oui, citoyen. Nous sommes prêts. »
Robespierre, toujours impassible, finit par acquiescer, mais non sans une dernière observation : « Alors je vous le dis, soldats de l’ancien régime : pour prouver votre loyauté, vos actes devront parler plus que vos paroles. Bienvenue dans la Révolution, mais n’oubliez pas que rien ne vous y garantit la clémence, ni même le salut. »
« Vous êtes ici pour défendre Paris, défendre la nation, et vous êtes, dès cet instant, des soldats de la Révolution, des citoyens soldats. »
Les mots furent prononcés avec une gravité qui sembla redéfinir l’air dans la pièce, et chaque membre de la troupe sentit la solennité du moment les envahir. Beaumain, Renaut et les autres soldats échangèrent des regards lourds de sens ; en un instant, leurs uniformes passaient de symboles royaux à ceux de la nouvelle armée du peuple.
Robespierre tourna alors un regard dur vers la fouine, qui, jusqu’à présent, semblait tâcher de se faire oublier dans un coin. « Vous allez rédiger les contrats, » ordonna-t-il, sa voix s’abattant comme un couperet. « Chacun garde son grade, » précisa-t-il d’un ton inflexible, avant de jeter un regard appuyé vers le sergent Renaut, « y compris les sergents. »
Le scribe, nerveux, hocha frénétiquement la tête, fouillant dans ses effets pour sortir de quoi rédiger les contrats. L’ambiance était à la fois solennelle et étrange, teintée d’une gravité palpable ; chaque mot prononcé scellait un pacte, engageait leur loyauté vers un avenir incertain.
« Vous serez nourris, blanchis, et logés. Quant à la solde… » Robespierre marqua une pause, son regard se posant de nouveau sur chacun d’eux, un éclat de fermeté dans les yeux, « elle arrivera, mais sachez qu’en ces heures de trouble, Paris peine à garantir de telles promesses. »
Un murmure parcourut la troupe, mais Beaumain, qui avait traversé la misère et vu de près la détresse du peuple, acquiesça fermement, comme pour signifier que la solde n’était pas une priorité. La conviction les portait ; ils savaient pourquoi ils étaient là, et Robespierre le savait aussi.
Après un dernier regard circulaire, le citoyen Robespierre tourna les talons et quitta la pièce d’un pas calme, mais empreint d’une autorité incontestable. Il laissait derrière lui, dans cette salle modeste, des hommes qui, en cet instant précis, sentaient leur destin basculer. Les papiers furent préparés par la fouine, qui fit signe aux soldats d’avancer un à un pour apposer leur signature, gravant ainsi leur nom dans la liste des premiers soldats de cette nouvelle armée révolutionnaire. Beaumain sentit le poids du moment lorsqu’il traça son nom, son regard intense et serein fixé sur le document. Il n’y avait pas de retour possible.
Quand tous eurent signé, la fouine leur tendit des cocardes tricolores — rouges, blanches et bleues — leur nouvelle appartenance marquée par cette simple étoffe, symbole d’une France en rébellion. Beaumain et les autres épinglèrent les cocardes à leurs uniformes militaires d’antan, qui prenaient alors une nouvelle signification. Dans ce geste, le poids de la tradition royale et celui de la loyauté révolutionnaire s’entremêlaient. Sous la lumière vacillante, les cocardes prenaient des reflets vifs et flamboyants, promesses d’une ère nouvelle pour eux tous. Beaumain serra les poings, se tenant droit aux côtés de ses compagnons d’armes. Ils faisaient maintenant partie de la Garde Nationale, première ligne de défense d’une nation en pleine mutation.
Dans la lumière déclinante d’un Paris encore en proie aux secousses révolutionnaires, la troupe rejoignirent leur nouvelle garnison, du côté de Denfert-Rochereau. Le bâtiment, un ancien couvent abandonné, érigé sur une architecture austère et massive, contrastait avec la poussière et le désordre des rues environnantes. Ses murs épais et ses voûtes de pierre, autrefois chargés de prières et de silence, semblaient désormais absorber le tumulte d’une centaine d’hommes fraîchement intégrés, dont la loyauté à la nation et aux idéaux révolutionnaires semblait bien plus chaotique que leurs uniformes dépareillés.
Beaumain et les autres entrèrent, fixant les recoins sombres du couvent. Le bâtiment portait encore les stigmates de son passé religieux, avec ses longs couloirs glacials, ses arcades aux pierres délavées et quelques fragments de croix encastrés dans les murs. Ils choisirent une salle excentrée et ils durent jouer un peu des coudes pour se l’approprier. En peu de temps, chacun aménagea une paillasse rudimentaire, arrangée sommairement pour maintenir une apparence d’ordre et de rigueur, une ligne droite comme une barricade invisible entre eux et le chaos qui régnait dans les autres pièces.
Le groupe jeta un premier regard aux hommes qui partageaient désormais leur caserne. La troupe était en effet hétéroclite, avec quelques visages encore lisses, trop jeunes pour l’art de la guerre, et d’autres burinés par l’expérience et la méfiance. Parmi eux, des mercenaires débraillés, des aventuriers et de vrais fauteurs de troubles — des hommes que Beaumain reconnut comme ceux qu’il avait, autrefois, pour mission de maîtriser dans les ruelles de la capitale.
Pressis, le plus nerveux d’entre eux, observa la foule avec dédain. Les poings serrés, il lança un regard indigné au reste de la troupe : « Ça ne peut pas durer comme ça… Ces hommes se croient tout permis, et personne ici pour imposer l’ordre. Il faut agir, ou ce couvent va se transformer en terrain de chasse pour les plus violents. »
Mais le sergent posa une main lourde sur son épaule, le regard grave et prudent : « Attends, Pressis. Ce soir, on observe. La force brute, ici, c’est un jeu dangereux ; on n’est que six, et il y en a un peu plus de cent, sans compter ceux qui n’hésiteront pas à trahir pour s’élever dans cette pagaille. »
La nuit tombée, chacun rejoignit une grande salle où l’on distribuait une soupe brune et grumeleuse dans des écuelles de fer cabossées. L’odeur de bouillon de légumes éventé emplissait l’air épais de la caserne. Si elle n’offrait guère de goût, la soupe avait l’avantage d’être chaude et consistante — « le genre de soupe qui cale, même si elle ne régale pas », pensa Dupois en avalant une première cuillerée. Mais la distribution des rations était un spectacle en soi. Les hommes, privés de discipline et laissés sans consignes précises, se pressaient et bousculaient pour obtenir une écuelle pleine. Des voix s’élevèrent, rudes et tonitruantes, des coudes frappèrent, et quelques rixes éclatèrent, mettant au jour une règle non écrite qui semblait désormais régner : celle du plus fort. Pressis, voyant la scène, serra à nouveau les poings, mais un regard de Renaut suffit à le ramener au calme.
« On veut être utiles ici, Pressis, pas commencer une guerre entre nous, » murmura Beaumain avec une fermeté tranquille. « Demain, nous observerons un peu plus attentivement, et nous verrons comment tirer le meilleur de ces hommes, comment leur enseigner un peu de cohésion, s’ils en sont capables. »
Au milieu de la cohue, ils retournèrent enfin à leur salle, la lourdeur de l’atmosphère pesant sur leurs épaules. Dans le couvent désaffecté, la nuit était rythmée par les échos de disputes et de quelques combats, des ombres d’hommes se battant pour des paillasses et de rares couvertures. Chaque coup porté résonnait dans les couloirs de pierre comme autant de rappels de leur nouvelle réalité.
Une fois isolés dans leur pièce, ils s’allongèrent enfin, chacun perdu dans ses pensées, mais unis par cette fraternité qui les séparait du chaos. Ce premier soir, ils comprirent que leur rôle dans cette Garde Nationale serait plus complexe que prévu. Demain, il faudrait peut-être commencer à imposer une forme d’ordre, une sorte de discipline pour transformer ce groupe de misérables en quelque chose de plus noble, d’utile, de prêt à défendre les valeurs qu’ils s’étaient engagés à protéger. Le changement était là, brutal et sans retour.
À l’aube du 16 juillet 1789, un sentiment d’inaction se faisait lourdement ressentir parmi les soldats de la Garde Nationale improvisée. La troupe observait les allées et venues dans la cour du couvent de Denfert-Rochereau, désormais transformé en caserne. La troupe, loin de l’élite disciplinée qu’ils espéraient, était une masse informe de plus de cent hommes, indisciplinés et hétérogènes, où se mêlaient artisans, jeunes recrues, et quelques citoyens engagés. Bien que le cœur de Pressis brûlait d’une détermination à instaurer un semblant d’ordre parmi eux, il ne fallait pas se leurrer : avec leur maigre nombre de vétérans, leur tâche serait ardue.
Face à cet esprit débridé et à l’urgence d’une quelconque discipline, ils décidèrent d’aborder une approche plus subtile. En se mêlant discrètement aux différents groupes, ils engagèrent des discussions anodines, tissant peu à peu des liens avec ces novices. Parfois, ils partageaient simplement quelques anecdotes de leurs campagnes passées. Mais très vite, les échanges se firent plus pratiques ; Beaumain prit soin d’observer l’état des mousquets, pointant leur manque flagrant d’entretien, de propreté, et, dans certains cas, d’éléments cruciaux. Les armes semblaient presque rouiller sous l’œil inattentif de leurs porteurs.
« Un mousquet en bon état, c’est bien plus qu’une simple arme, » commenta Beaumain à un petit groupe rassemblé autour de lui. « C’est votre vie en cas de conflit. Une mèche défectueuse, une platine mal fixée, et vous êtes bon pour la potence ou pire, le ridicule face à l’ennemi. »
Ses mots commencèrent à attiser la curiosité de certains. Il y avait là, chez ces nouveaux soldats, un désir de comprendre, de se sentir plus confiants dans ce monde incertain. Doucement, des novices vinrent chercher conseil, leur demandant des astuces, des techniques d’entretien. Pressis et les autres en profitèrent pour leur rappeler l’importance de savoir utiliser une arme avec précision, surtout face à une rareté alarmante de poudre et de munitions.
Tout cela n’allait pourtant pas sans heurts. Babin, intrépide mais impétueux, fut confronté à une altercation lors d’un atelier d’armement improvisé. Un jeune exalté, exaspéré par les conseils insistants du vétéran, en vint aux mains, tailladant légèrement la joue de Babin avant que la tension ne retombe. Le calme revint, mais non sans une trace d’amertume dans le regard de Babin, bien conscient des défis d’une telle formation hâtive.
Hugel, de son côté, souffrait sous un autre angle. Plus frêle et réservé, sa silhouette contrastait avec l’image du soldat endurci. Quelques rumeurs circulaient sur lui, des murmures et des regards moqueurs qu’il subissait en silence. Mais sa persévérance et le soutien discret de Beaumain maintinrent sa place au sein de la troupe, étouffant les railleries et réaffirmant leur cohésion face aux autres. Car au-delà des moqueries et des défis, une forme de respect s’instaurait. Le sergent insistait sans relâche : chacun ici devait avoir confiance en l’autre, non pas comme des camarades de circonstance, mais comme des frères d’armes, unis face aux incertitudes qui les guettaient.
Petit à petit, l’idée d’atelier de formation pour l’entretien et le maniement des mousquets fit son chemin. Les plus jeunes, avides d’apprendre et de prouver leur valeur, vinrent demander conseil sans attendre. Ils prirent même l’initiative de monter un stand rudimentaire, où la troupe put enseigner des bases cruciales : nettoyer, charger, viser, et tirer avec parcimonie. Le cliquetis des fusils s’ajouta bientôt aux sons réguliers des entretiens ; une symphonie discrète, prélude à une cohésion militaire en germe.
Avec le temps, une nouvelle atmosphère imprégnait la caserne. Les regards changeaient, passant de la méfiance au respect. Peu à peu, la troupe du Sergent Renaut imposait sa présence, inspirant ces novices à suivre un exemple de discipline et de solidarité. Il restait beaucoup à faire pour transformer cette assemblée en une véritable force défensive, mais le potentiel était là, et ils commençaient enfin à entrevoir une force unie, ancrée dans le même désir d’un avenir meilleur, d’une nation renaissante.
La soirée du 16 juillet 1789 s’avérait particulièrement morose pour la troupe. Autour d’un repas d’une fadeur désespérante, les hommes mâchaient leurs portions avec un dégoût visible. « On dirait de la semelle d’usure, » murmura Pressis en jetant un regard exaspéré sur sa gamelle. L’odeur âcre d’un ragoût raté flottait dans la salle, et même les plus affamés peinaient à s’imposer ce sacrifice culinaire. Beaumain, dont l’estomac solide avait bravé bien des batailles, fronça les sourcils : il était temps de voir qui se cachait derrière cette catastrophe gustative.
Lorsqu’ils pénétrèrent dans la cuisine, ils tombèrent nez à nez avec une vision pour le moins inattendue. Au milieu des marmites et des bouilloires fumantes, se dressait une montagne de muscles : un colosse, plus imposant encore que Beaumain lui-même, aux mains énormes qui s’agitaient pour remuer un ragoût douteux. Tout en sueur, il semblait aussi à l’aise en cuisine qu’un poisson hors de l’eau. Beaumain tenta de s’approcher : « Compagnon, tu aurais peut-être besoin d’un coup de main ? » Mais le géant se retourna d’un air farouche. « J’ai reçu la charge de la cuisine, pas question que qui que ce soit mette son nez là-dedans ! »
L’échec de la tentative diplomatique faisait grincer des dents la troupe. Babin lança un regard en coin à Beaumain, comme pour lui suggérer un autre plan : dénicher un vrai cuistot. Avec un peu de chance, ils pourraient convaincre ce géant entêté de s’en remettre à un expert. Après quelques recherches, ils finirent par dénicher un cuisinier chétif, dont la silhouette frêle rivalisait avec celle de Hugel. Cependant, face à l’idée de le mettre en tête-à-tête avec leur colosse cuisinier, tous échangèrent des regards sceptiques : le pauvre homme serait écrasé en un instant.
De retour aux cuisines, Beaumain tenta une dernière approche. « Écoute, on sait que tu fais de ton mieux, mais laisse au moins notre cuistot t’aider un peu ! » Mais le géant restait sourd à toute supplication. Exaspéré, Beaumain, dont la patience avait atteint ses limites, tenta le tout pour le tout : il le provoqua. Le colosse, dont les yeux s’éclairèrent aussitôt à cette idée, esquissa un sourire avant de lever ses poings, prêt pour le combat.
En un clin d’œil, ce qui devait arriver arriva. Le géant envoya valser Beaumain d’un revers de poing, propulsant notre valeureux soldat contre un tas de gamelles dans un fracas assourdissant. Sonné, Beaumain tentait de reprendre ses esprits tandis que Babin, qui n’avait pas dit son dernier mot, s’approcha prudemment. C’était une question de stratégie désormais, et Babin scruta la silhouette imposante de leur adversaire avec attention. Son regard se figea sur une étrange grosseur surgissant de l’arrière du pantalon du colosse.
D’un bond agile, Babin décocha un coup de pied bien calculé sur cette excroissance. Le colosse poussa un cri de douleur retentissant, s’écroulant au sol, gémissant et se recroquevillant comme un enfant blessé. Le malheureux, apparemment affligé d’un furoncle gênant, était hors d’état de nuire. Voyant la scène, la troupe hésita entre le rire et la compassion. Finalement, dans un élan de bienveillance, ils l’aidèrent à se relever, lui assurant qu’ils n’étaient pas là pour lui nuire mais pour l’aider.
À bout d’arguments – et probablement plus pressé d’éviter tout autre affrontement – le colosse finit par accepter la proposition de la troupe : il se plierait aux conseils d’un vrai cuistot. Peu après, sous la supervision de leur expert, une soupe digne de ce nom fut enfin servie. Le changement de saveurs fit un effet immédiat ; l’atmosphère se détendit et les visages des soldats s’illuminèrent. Pour la première fois, un vrai repas chaud et savoureux calmait leurs estomacs affamés, et le moral de la troupe grimpa en flèche.
En cette journée où une simple question de cuisine avait bien failli dégénérer, un sentiment de fierté envahit les hommes. Ils étaient sur la bonne voie, chaque petit obstacle surmonté renforçait leur union. Ils avaient non seulement gagné un bon repas, mais aussi un respect mutuel qui, ils en étaient persuadés, leur serait bien utile dans les combats à venir.
Dans l’air lourd de cette soirée du 17 juillet 1789, l’ambiance parmi les soldats était à la fête, ou plutôt à une distraction bienvenue. Le moral des troupes étant fragile, certains avaient organisé une soirée de détente en compagnie de quelques filles de joie, une occasion qui n’allait pas sans débat pour Pressis, jeune et toujours chaste.
Au moment où il enfilait son habit le plus convenable pour l’occasion, il fut interrompu par Babin. Il l’observa d’un regard suspicieux et tenta de le ramener à de meilleurs sentiments :
— « Dis donc, Pressis, tu ne vas pas faire quelque chose que tu pourrais regretter, si ? » murmura-t-il en posant une main rassurante sur son épaule. « Tu penses à Mélodie ? »
Pressis, un peu troublé, baissa les yeux, la honte et la culpabilité alourdissant ses traits. Mais malgré lui, un feu ardent persistait dans son regard.
— « Je… J’y pense, Babin. Crois-moi, Mélodie est toujours dans mon cœur. Mais depuis cette conversation avec… Sade, il m’a comme ouvert les yeux. Pour lui, nos désirs les plus enfouis n’ont rien de honteux. C’est la Nature elle-même qui nous guide. Pourquoi lutter contre ce qu’elle nous ordonne ? »
Babin fronça les sourcils, comprenant que quelque chose s’était immiscé en Pressis, comme une graine empoisonnée, plantée par cet écrivain de la Bastille. Il prit une grande inspiration et répondit avec douceur, mais fermeté :
— « Pressis, l’amour n’est pas qu’une affaire de désir. Ce que tu ressens pour Mélodie est bien plus précieux que ces plaisirs passagers. Tu parles de Nature, mais les bêtes elles-mêmes connaissent des engagements. As-tu vraiment besoin de renoncer à cet amour pour une simple tentation ? Ce Sade… il te parle d’un monde sans honneur, où chacun n’obéit qu’à ses pulsions. Mais est-ce ça, la vie que tu veux ? »
Hésitant, Pressis se passa une main nerveuse dans les cheveux. Sade lui avait pourtant dit que les interdits religieux, la morale même, n’étaient que des constructions humaines sans vraie légitimité.
— « Peut-être… Peut-être que nous nous trompons tous sur ce que la morale nous enseigne. Peut-être que Sade a raison et que le plaisir n’est pas un péché, mais une voie vers notre liberté véritable. »
— « Et c’est le bonheur que tu cherches ainsi ? » répondit Babin, tentant de raviver la flamme pure de son compagnon. « Et si ce n’était que de la perdition ? Tu es jeune, toi. Ton amour pour Mélodie, il est bien réel, pas un caprice passager. Dis-moi, si tu n’avais pas les idées de Sade dans la tête, cela t’aurait-il seulement effleuré l’esprit ? »
Pressis allait répondre lorsqu’ils furent rejoints par Beaumain et Hugel, qui prirent immédiatement part au débat, sans la moindre retenue. Hugel, avec son sourire narquois, commença par un bon mot :
— « Alors, on attend pas Hugel ?! » lança-t-il, provoquant un léger rire parmi ses camarades.
Puis, voyant le sérieux de la discussion, il ajouta d’un ton plus grave, mais toujours aussi cru :
— « Pressis, écoute : d’accord, l’envie te prend, mais pourquoi courir la gueuse, hein ? Tu veux un bon conseil ? Secoue-toi la nouille, ça t’évitera bien des ennuis ! »
Beaumain, qui jusque-là avait observé avec attention, prit à son tour la parole, se faisant un peu plus explicite :
— « Hugel a raison, Pressis. Tu veux mettre en danger ce que tu as de plus précieux pour une nuit ? Et sais-tu seulement à quoi tu t’exposes ? La vérole, mon ami ! La gale, les pustules, et pire encore. » Il marqua une pause en prenant un air solennel. « Tu t’imagines, défiguré, voire pire… la mort ! Une mort lente et atroce. Et si, un jour, tu retrouves Mélodie, tu vas risquer de lui refiler ça ? »
Pressis, les joues rougies par l’embarras et la honte, baissa les yeux. Babin, voyant qu’il était encore tiraillé, s’approcha et, d’une voix douce, reprit :
— « Mon ami, je ne te dis pas que ce désir n’est pas humain, mais écoute-moi bien. La doctrine de Sade, c’est le chaos. La liberté dont il parle n’est qu’une absence de morale qui nous conduit au malheur. Mélodie, elle, c’est le vrai bonheur. Crois-moi, l’amour te donnera bien plus que cette nuit de luxure. »
Pressis soupira, pris dans cette tempête intérieure. D’un côté, la voix de Sade, enivrante, qui lui chuchotait la promesse d’un monde sans barrières, où la Nature commandait de suivre ses pulsions sans entrave. De l’autre, ses compagnons, et cet amour pur pour Mélodie, si fragile mais si réel, ancré dans son cœur. Il savait, au fond de lui, qu’ils avaient raison.
Finalement, Pressis acquiesça, un léger sourire aux lèvres, comme soulagé de céder à la sagesse.
— « Vous avez raison… Je ne vais pas tout gâcher pour une illusion. Ce soir, je resterai ici. Ce sera pour une autre fois… Ou pour jamais. »
Et, dans un geste de franche camaraderie, Beaumain le frappa amicalement dans le dos tandis que Hugel lançait un dernier commentaire :
— « Tant mieux ! Le sergent Renaut, lui, est déjà parti ! »
Les jours qui suivirent le 14 juillet 1789, Paris s’embrasa d’un nouvel esprit. Dans une atmosphère chargée d’espérance et de transformation, le roi lui-même fut contraint de se plier à la volonté populaire. Accompagné de sa cour et de ses gardes, il quitta Versailles pour rejoindre le Palais des Tuileries, installé désormais en plein cœur de Paris sous les regards intenses des citoyens. C’est dans ce décor que se manifesta une scène symbolique d’une grande puissance : le marquis de La Fayette, de retour des Amériques et auréolé de sa gloire de général, devint le chef de la toute nouvelle Garde nationale. Imposant et solennel, La Fayette plaça lui-même une cocarde tricolore – symbole de cette nouvelle alliance entre la monarchie, la ville de Paris, et le peuple – sur le chapeau du roi. Ce geste, quoiqu’accompli avec une feinte légèreté, était imprégné d’une charge symbolique redoutable : Louis XVI, à contrecœur, semblait accepter d’endosser une part de cette révolution qui grondait aux portes de son palais.
La cocarde tricolore devint dès lors le signe d’unité pour tous les Parisiens, une marque d’appartenance collective. Nobles et bourgeois se virent supplantés par une identité nouvelle : celle de « citoyen ». Ce mot, chargé de liberté et de fraternité, résonnait dans les ruelles et sur les places, détrônant ainsi les distinctions de classe qui avaient jusque-là structuré la société française. Ce fut aussi sous la pression inéluctable de cette vague populaire que Louis XVI rappela Necker, économiste éclairé et ministre favori du peuple, qu’il avait renvoyé quelques jours avant la prise de la Bastille, et ordonna le retrait des troupes étrangères stationnées autour de Paris, répondant ainsi à une exigence populaire qui voyait en elles une menace directe.
Pour la troupe, les semaines qui suivirent cet événement étaient empreintes d’une atmosphère calme mais chargée de tension. La ville, bien que libérée de la menace militaire, n’était pas apaisée pour autant. En collaboration avec les nouvelles patrouilles de la Garde nationale, leur mission de maintien de l’ordre consistait à assurer la sécurité des quartiers populaires tout en observant de près l’agitation politique qui montait dans les tavernes et sur les marchés. La population, galvanisée par cette transition, osait désormais discuter ouvertement des questions de pouvoir, et même critiquer la noblesse sans crainte des représailles. Cette routine nouvelle, bien que structurée, ne masquait pas l’angoisse d’une population en quête d’avenir, déchirée entre l’euphorie de sa liberté nouvelle et l’incertitude de ce qui suivrait.
À mesure que juillet avançait, l’Assemblée constituante fit avancer des réformes marquantes qui modifièrent à jamais la société française. Le 4 août 1789, après des semaines de débats et sous la pression des émeutes paysannes dans les provinces, l’Assemblée vota l’abolition des privilèges. Ce soir-là, dans une séance mémorable, les représentants des nobles, des prêtres, et même certains bourgeois se levèrent et, dans une suite de déclarations solennelles, renoncèrent à leurs privilèges féodaux et à leurs droits exclusifs. Les droits seigneuriaux furent abolis, les privilèges de la noblesse et du clergé balayés d’un geste, marquant la fin du système féodal qui avait jusqu’alors organisé la société française. Cette abolition, acclamée par la foule parisienne, constituait une avancée prodigieuse pour le peuple et une première étape vers l’égalité juridique.
Dans les jours qui suivirent, la ferveur patriotique imprégnait davantage encore les rues de Paris. La société s’ouvrait à une ère nouvelle, où les distinctions de naissance s’effondraient devant le principe d’égalité. À l’Assemblée, les débats philosophiques et juridiques débouchaient sur la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, adoptée le 26 août. Inspirée par les philosophes des Lumières et par les idéaux des révolutions américaine et anglaise, cette déclaration érigea en principes fondamentaux la liberté, l’égalité, et la souveraineté du peuple. La société française tout entière semblait bouleversée par cette proclamation, qui garantissait à chacun des droits naturels et imprescriptibles, notamment la liberté d’expression, l’égalité devant la loi, et le droit de propriété.
Paris, dans cette période charnière, reflétait les contrastes de cette nouvelle ère. Les quartiers populaires bruissaient de débats passionnés et de rêves d’avenir. Les anciennes barricades laissaient place aux attroupements de citoyens venus discuter des décisions de l’Assemblée, échanger des pamphlets, et écouter les discours impromptus de tribuns émergents. Le long des ruelles étroites, les cafés et les clubs politiques se multipliaient, accueillant de jeunes orateurs exaltés et des pamphlétaires à la plume acérée. Les Halles, lieu de commerce, était aussi devenu le cœur de l’agitation sociale : paysans, artisans, soldats, bourgeois – tous se croisaient et débattaient librement, partageant l’espoir d’une France plus juste.
La routine de la troupe s’enracinait peu à peu dans cette nouvelle vie. Les patrouilles de sécurité s’organisaient en coordination avec la Garde nationale, veillant à maintenir un ordre fragile dans une ville survoltée. Les anciens symboles de l’Ancien Régime, pourtant bien ancrés, commençaient à disparaître, alors que les signes de la nouvelle société, comme la cocarde tricolore et le salut de « citoyen », devenaient la norme. Ce renouveau, cette fusion entre la défense de l’ordre et l’effervescence révolutionnaire, imprégnait chaque rue, chaque place, chaque visage croisé.
Ainsi, cette fin d’été 1789, marquée par l’abolition des privilèges et la déclaration des droits de l’homme, incarna pour Beaumain et les siens non seulement une victoire collective, mais aussi un basculement irréversible de la société française.