Juin 1794
Il est des moments dans l’existence où l’âme vacille, où la raison, confrontée à l’indicible, s’effrite comme un vieux parchemin rongé par l’humidité et les âges. Aujourd’hui, au seuil de cette nouvelle journée, je me trouve contraint de commencer ce journal de bord, non par vanité ou par désir de postérité, mais par une impérieuse nécessité : celle de préserver les lambeaux de ma santé mentale et de consigner l’incompréhensible.
Pourquoi maintenant ? Pourquoi en plein milieu d’une odyssée que j’aurais préféré ne jamais entreprendre ? Je ne saurais répondre. Peut-être parce que l’esprit cherche désespérément à donner un sens à l’absurde, à lier les fragments épars d’une réalité fracturée. Peut-être aussi parce que, hier soir, un livre maudit est venu troubler mon âme, révélant des vérités si terrifiantes que la langue humaine peine à les nommer. Ce livre, murmure d’un autre temps, d’une autre réalité, m’a arraché les voiles de l’ignorance. Il m’a fait entrevoir l’insignifiance de l’homme face aux forces occultes qui, tapies dans les ombres, jouent de nos vies comme un musicien de ses cordes.
En couchant ces mots sur le papier, j’espère naïvement que ces récits d’horreur pourront un jour éclairer une âme désespérée, tout comme, en cet instant, je supplie les cieux de m’envoyer un secours. Peut-être, à travers ces pages, parviendrai-je à transmettre une lueur vacillante à ceux qui, comme moi, sombreraient dans le gouffre du doute et de la folie.
Je ne puis taire plus longtemps les événements de ces dernières heures. À l’aube du 4 juin 1794, après une nuit que mes mots ne pourront jamais rendre justice, je me suis retrouvé face à Guillaume, un être dont la nature défie toute classification terrestre. Il est une goule. Oui, une goule, cette créature des légendes macabres, ces récits que l’on murmurait autour des feux de camp pour effrayer les jeunes recrues. Pourtant, ce n’était ni un conte ni un délire. Guillaume était là, tangible, sa peau cireuse et son souffle chargé de l’odeur des cryptes.
Mais, paradoxalement, c’est à lui que nous devons notre survie. Lui, cet être des ténèbres, a risqué son existence — si tant est que l’on puisse employer ce mot pour une telle créature — pour nous arracher des griffes du Docteur Rigaut. Ce nom seul provoque encore en moi un frisson glacial. Rigaut, cet homme qui avait autrefois l’apparence de l’érudition et de la raison, est désormais l’incarnation du cauchemar. Les symboles macabres qui dansent sur sa peau, ces crânes noirs et mouvants, semblent le rendre invincible. Je l’ai vu marcher, impassible, au milieu de son armée de morts recomposés, ces pantins grotesques et hétéroclites qu’il animait par une force que je ne puis comprendre.

04 juin 1794 – Parc des Invalides, aube
Une nuit terrifiante venait de s’achever, et dans la pénombre déclinante, mes pas lourds me guidaient vers la caserne, aux côtés d’une troupe harassée et silencieuse. Le Parc des Invalides, habituellement si paisible à cette heure, résonnait encore dans mon esprit des échos de la bataille. Chaque bruissement des feuilles, chaque ombre mouvante semblait une réminiscence des horreurs nocturnes.
Ce fut un cheminement mécanique, presque irréel, comme si mon corps agissait d’instinct tandis que mon esprit, meurtri, s’égarait dans les abysses des récents souvenirs. Il était cinq heures et demie lorsque nous atteignîmes enfin la caserne. Le soulagement de retrouver ce bastion familier fut terni par une étrange sensation, une impression que ce refuge même ne pourrait me protéger de l’invisible qui nous traquait désormais.
10h – Caserne, réveil
Le sommeil, bien que bref, avait quelque peu apaisé nos corps meurtris. Mais la fatigue restait omniprésente, tapie derrière chaque regard. À mon réveil, une idée m’obsédait : retrouver un camarade que je savais versé dans les rudiments de la médecine. Il n’était ni docteur ni sage, mais ses connaissances suffisaient pour traiter nos blessures visibles. Après quelques recherches dans le dédale de la caserne, je le trouvai enfin. Avec méthode et patience, il s’attela à recoudre, panser, et nettoyer mes plaies et celle de mes frères d’armes.
Cependant, lorsque je vis ses mains expertes travailler, un frisson parcourut mon échine. Si les chairs pouvaient se refermer, les cicatrices de l’âme, elles, demeuraient béantes. Aucune science humaine ne pourrait effacer les visions cauchemardesques qui nous hanteraient à jamais.
Midi – Cantine, puis chambre privative
Un repas frugal mais réconfortant — du jambon braisé accompagné de fayots — fut partagé dans un silence pesant. Nous avions décidé de nous isoler dans notre chambre commune, à l’écart des bruits de la caserne, comme si l’intimité pouvait contenir nos pensées troublées.



Le souvenir de cette nuit infernale refusait de s’éteindre. À chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais la scène comme une gravure impie sur la paroi de mon esprit. Rigaut, cette abomination revenue d’entre les morts, et ses pantins grotesques animés par une force contre-nature… mais ce n’étaient pas eux qui hantaient le plus mon esprit. Non, c’était cette image que je n’osais croire : le sergent Renault, tournant les talons au moment où nous étions encerclés, nos vies suspendues à un fil.
Je me rassurais, cherchant en vain une autre explication. Peut-être avait-il vu une opportunité que je n’avais pas saisie dans la folie ambiante. Peut-être agissait-il selon un plan que seule sa position lui permettait d’apercevoir. Mais ces excuses s’effritaient, et avec elles, ma patience.
Assis sur ma couche, tandis que mes camarades s’agitaient dans la pièce exiguë, je sentais une chaleur sourde monter dans ma poitrine. Ma colère, longtemps contenue, devenait insupportable. Enfin, je me levai brusquement et me tournai vers Renault.
— Sergent, il faut que je parle. Je ne peux plus garder ça pour moi.
Lui, surpris, se redressa et posa sur moi un regard mêlé de lassitude et de défi.
— Que voulez-vous, Beaumain ? répondit-il d’un ton sec.
La tension dans la pièce était palpable. Tous les regards s’étaient tournés vers nous, suspendus à cette confrontation que chacun savait inévitable.
— Lors de la bataille avec Rigaut, vous nous avez abandonnés.
Mes mots frappèrent comme un coup de tonnerre. Le sergent fronça les sourcils, comme pour contenir sa propre colère.
— Je n’ai pas fui ! s’écria-t-il. J’ai vu une opportunité de sauver tout le monde, et je l’ai saisie !
Je fis un pas en avant, mon regard vrillant le sien.
— Sauver tout le monde ? Vous voulez dire : sauver votre peau pendant que nous étions en train de lutter pour rester en vie ?
— Je vous ai appelés ! rétorqua-t-il. Je vous ai demandé de me rejoindre dès que j’ai pu.
— Non, Sergent. Vous nous avez appelés une fois à l’abri, quand nous étions déjà en train de nous battre contre ces choses… sans votre aide.
À mesure que mes mots s’enchaînaient, je vis quelque chose vaciller dans son regard. Il n’était plus aussi sûr de lui.
Hugel, toujours prompt à soutenir une vérité qui le touchait, intervint :
— C’est vrai, Sergent. Sans Beaumain, je ne serais peut-être plus là pour vous le dire.
Renault ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Ses traits s’affaissèrent légèrement, comme s’il comprenait enfin l’ampleur de ses actes.
— Un bon sergent, repris-je, ma voix tremblante d’émotion contenue, part en dernier, pas en premier. Il doit organiser la retraite, pas laisser ses troupes en plan. C’est facile de nous dire de vous suivre quand vous êtes déjà hors de danger. Nous, nous étions là, au milieu des cadavres animés et de cette créature infernale. Vous, vous étiez… ailleurs.
Un long silence s’installa, lourd et pesant. Renault baissa les yeux, comme accablé par le poids de mes accusations. Il finit par murmurer, plus pour lui-même que pour nous :
— Je voulais bien faire… Je pensais…
Mais il n’y avait plus rien à dire. La pièce demeura muette, chacun absorbé dans ses propres pensées. La colère en moi retomba, laissant place à une lassitude infinie. Je connaissais Renault. Je savais qu’il n’était pas lâche, mais humain, faillible comme nous tous. Et malgré cette erreur, nous resterions unis.
Le serment tacite de notre unité n’était pas brisé. Mais il était ébranlé, comme une corde tendue qui aurait frôlé la rupture. Quant à moi, il ne restait plus qu’un sentiment d’épuisement, l’impression d’avoir fait ce qu’il fallait pour que nous avancions à nouveau, ensemble.
“Pour moi, c’est fini.”
Nous savions pardonner, car nous avions partagé bien trop d’horreurs pour nous laisser diviser par une seule erreur. Le silence qui suivit était une promesse muette : celle de toujours avancer, unis dans l’adversité, malgré nos failles humaines.

Alors que je demeurais plongé dans mes pensées tourmentées, un murmure de plus en plus distinct m’arracha à ma rêverie. Les voix de mes camarades montaient en intensité, une discussion que je ne pouvais plus ignorer. Je les écoutai, absorbant peu à peu le sens de leurs paroles. Une question simple, mais cruciale, résonnait entre eux : que faire maintenant ?
Très vite, un consensus naquit. Nous ne pouvions rester passifs, spectateurs de l’horreur. L’inaction était un luxe que nous ne pouvions nous permettre. Le choix s’imposait de lui-même : il fallait confisquer le sinistre grimoire noir, relié d’étain, qui semblait être à la source de tant de malheurs. Ce maudit ouvrage, véritable abîme d’ombre et de secrets, était entre les mains du docteur Rigaut. La goule — cette créature grotesque et pitoyable — nous avait indiqué son adresse. Désormais, le temps des discussions était révolu. Nous allions agir.
Pourtant, je ne pouvais ignorer un frisson glacé qui remontait le long de mon échine. Rigaut n’était pas un homme ordinaire, et son influence, bien que voilée, était palpable. Pénétrer son territoire, même armés de nos convictions, revenait à s’aventurer sur le seuil d’un gouffre béant. Nous étions, après tout, de simples soldats de la garde nationale, jetés dans une lutte bien au-delà de notre entendement.
Nous trouvâmes sans peine l’adresse de Rigaut, un bâtiment élégant, presque un hôtel particulier. Son allure, malgré son opulence discrète, portait les marques de la Révolution. Au-dessus de la porte, un blason autrefois noble avait été arasé et repeint d’un noir uniforme, une tentative évidente de gommer toute trace de privilège en ces temps où se réclamer du peuple était une question de survie.
Face à cette demeure inquiétante, une auberge modeste s’offrait comme un refuge. Si je n’y voyais qu’un poste d’observation pratique, Dupois, lui, sembla immédiatement séduit. Son visage s’illumina d’un sourire presque enfantin lorsqu’il franchit la porte, et, sans surprise, il se mit à boire dès qu’il le put.
Nous prîmes position, observant patiemment le bâtiment. La chance ne tarda pas à tourner. Peu après notre arrivée, Rigaut sortit de chez lui, marchant d’un pas vif vers les quais de la Seine. Hugel, que j’entendis marmonner « ce bon docteur Rigaut », se leva instinctivement, lui emboîtant le pas à une distance prudente. Dans mon esprit, une pensée amère surgit : Et merde.
Je connaissais Hugel. Sa foi aveugle en la rédemption humaine était aussi noble qu’insensée. Il croyait fermement qu’il pouvait ramener Rigaut dans le droit chemin, malgré l’évidence écrasante de sa corruption. Une partie de moi espérait qu’il réussisse, mais au fond, je savais que c’était une chimère. Rigaut n’avait pas simplement dévié du sentier de la morale ; il s’était enfoncé dans des ténèbres si profondes que l’idée même de lumière semblait absurde.
Mais Hugel était déjà parti. Il n’y avait plus rien à faire si ce n’était espérer qu’il ne se jette pas tête baissée dans l’abîme. Pendant ce temps, je me concentrai sur une approche plus prudente : l’observation et la patience.
Avec Renault, je fis le tour du bâtiment, cherchant une entrée discrète, une porte dérobée réservée aux domestiques ou un accès vers une cave. Mais nos efforts furent vains. Chaque issue était hermétiquement close, et le temps pressait. Revenus à notre poste, nous continuâmes à observer, guettant le moindre signe d’opportunité.
C’est alors que Babin, incapable de supporter cette attente, prit une initiative aussi audacieuse qu’imprudente. Il se blessa volontairement, enroulant sommairement un bandage autour de sa main, et se leva, décidé à confronter directement Rigaut. Même le tenancier de l’auberge, visiblement peu dupe de sa blessure superficielle, ne parvint pas à le dissuader. Avec l’aide de Dupois, déjà quelque peu éméché, il franchit la rue et frappa à la porte de Rigaut.
De notre poste d’observation, nous les vîmes converser brièvement avec un domestique austère, qui les éconduisit sans ménagement après quelques mots. Babin et Dupois revinrent rapidement, l’air penaud, prenant soin de faire un détour pour éviter les regards suspicieux du domestique qui les observait depuis la porte. Une fois de retour, Babin grogna quelque chose d’inintelligible, et Dupois, dans un rire nerveux, se contenta de hausser les épaules. Notre maigre tentative s’était soldée par un échec.

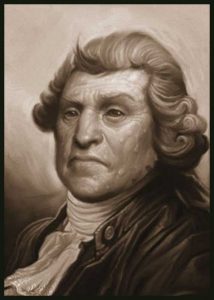

Lorsque Hugel revient, une expression étrange, presque béate, éclaire son visage, comme s’il venait de participer à un échange bénin, une discussion entre gens de bonne compagnie. Mais dès qu’il ouvre la bouche pour nous rapporter son entrevue, mon sang se glace, et je sens un gouffre s’ouvrir sous mes pieds. Chaque mot qu’il prononce alourdit l’atmosphère, transformant cette auberge modeste en un tribunal de l’esprit où la sentence s’écrit déjà dans les ombres.
Hugel raconte, avec sa naïveté désarmante, comment il a rencontré le docteur Rigaut. Selon lui, ce dernier ne montrait aucune hostilité, mais un détachement étrange, presque mécanique, comme si les événements récents ne le concernaient pas. Rigaut feignait l’ignorance la plus totale : il affirmait n’avoir aucun souvenir de la veille, encore moins d’une visite nocturne dans les catacombes. Cela seul aurait dû alerter Hugel, mais son désir de croire à la rédemption de cet homme aveuglait son jugement.
Hugel, fidèle à lui-même, avoue avoir abordé le sujet avec une franchise désarmante. Il avait osé dire à Rigaut qu’il voulait l’aider à redevenir “le bon docteur”. Une intention noble, mais terriblement naïve face à un homme de la trempe de Rigaut. Selon les dires de Hugel, le docteur, d’un sourire poli mais insondable, avait rétorqué que peut-être, c’était lui, Hugel, qui nécessitait de l’aide psychologique. Cette simple phrase, apparemment anodine, résonne en moi comme un avertissement voilé, une menace déguisée dans le velours de la bienséance.
Ce qui suit achève de me faire blêmir. Rigaut avait demandé, presque innocemment, si Hugel était toujours stationné à la même caserne, avec notre troupe et sous les ordres du sergent Renaut. Et Hugel, n’y voyant rien de mal, avait confirmé. Il ne réalise pas ce qu’il vient de livrer à cet homme, mais moi, je le sais. Je le sais trop bien.
La conversation s’était conclue sur une note que Hugel, dans son enthousiasme, qualifie de positive : Rigaut lui avait promis d’écrire une lettre de recommandation. Une lettre adressée à François Héron. Ce nom, lorsqu’il franchit les lèvres de Hugel, provoque une onde de choc dans la pièce. Mon estomac se noue, et je vois le visage du sergent Renaut se figer dans une expression d’effroi que je ne lui avais encore jamais vue.
François Héron. Une ombre sinistre dans le cercle de Robespierre, son bras vengeur, celui qui transforme les accusations en sentences, et les suspects en cadavres guillotinés. À ses oreilles, une lettre n’est pas une demande ; c’est un verdict, une condamnation sans appel. Une mention de notre nom dans une telle correspondance signerait notre arrêt de mort. Hugel, inconscient du désastre qu’il a déclenché, continue de sourire. Je voudrais lui crier de se taire, mais les mots me manquent, étouffés par la panique.

Le monde, déjà ébranlé par la Révolution, vacille autour de nous. Nous sommes piégés, dénoncés avant même d’avoir eu l’occasion de nous défendre. Retourner à la caserne ? Impossible. Chaque regard pourrait être celui d’un espion, chaque ombre celle d’un bourreau. Le nom de François Héron pèse comme une épée de Damoclès, mais nous savons qu’il nous reste un bref répit. Le temps que Rigaut rédige sa lettre et que cette dernière parvienne à Héron, nous disposons de quelques heures, peut-être un jour ou deux, avant que les rouages de la machine infernale ne se mettent en marche et nous force à la clandestinité.
Hugel. Ah, ce brave Hugel. Malgré ses maladresses, je ne pouvais me résoudre à lui en vouloir. Son esprit pieux et son cœur généreux l’avaient poussé à tenter de ramener Rigaut sur le droit chemin. Il avait cru, naïvement, qu’un dialogue honnête pourrait briser les chaînes invisibles qui liaient l’esprit du médecin à ses obscures machinations. Il en revenait désabusé, le regard empreint d’une douleur sourde, mais il avait fait ce qu’il fallait. Maintenant, nous étions unis, tous. Arrêter Rigaut n’était plus une question morale, mais une nécessité absolue.
La journée s’étira dans une attente pesante, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Les murs de l’auberge, tachés de fumée et imprégnés de rumeurs, semblaient vibrer sous l’intensité de nos réflexions. Babin, bien qu’affaibli par ses blessures, se joignit aux discussions, affirmant avec une conviction presque prophétique que la solidarité de la troupe était notre seul rempart contre l’abîme. Chacun acquiesça en silence, le poids de la tâche à venir pesant lourdement sur nos épaules.
Au crépuscule, une agitation inhabituelle troubla la quiétude de la rue. Un fiacre s’arrêta devant la demeure de Rigaut, et nous observâmes avec une fascination mêlée de crainte les silhouettes qui en descendirent. Robespierre lui-même, le visage tranchant et austère, entra dans la maison en compagnie de Fouquier, le procureur de Paris, et d’un autre homme que nous ne parvînmes pas à identifier. La scène était irréelle, presque théâtrale. Quelles conspirations, quels pactes impies pouvaient bien se tramer derrière ces murs ?
Robespierre repartit rapidement, mais ses acolytes restèrent. Ce n’est qu’aux alentours de 23 heures que la maison s’apaisa. Le dernier domestique sortit enfin, refermant soigneusement la porte derrière lui avant de disparaître dans les ténèbres. L’heure était venue. Le moment d’agir ne souffrait plus d’aucun délai.
Je me tournai vers mes compagnons, leurs visages baignés d’ombres profondes mais illuminés par une détermination sans faille. Un murmure s’éleva dans la nuit, porté par le vent qui s’engouffrait dans les ruelles désertes : « C’est maintenant ou jamais. » Les minutes suivantes se déroulèrent dans un silence lourd, chaque mouvement amplifié par le battement frénétique de nos cœurs. Nous étions sur le point de franchir une ligne invisible, de nous jeter dans les entrailles d’une nuit qui ne nous rendrait peut-être jamais.

C’est dans un silence presque religieux que nous nous mîmes en route, l’obscurité étouffant le moindre de nos pas. Babin, fidèle et déterminé, tenta en premier lieu de forcer l’entrée avec une adresse qui ne lui était pas coutumière. Mais les subtilités du crochetage ne sont pas affaire de brute, et la serrure lui résista. Ce fut alors que Dupois, notre compagnon aux élans imprévisibles, et légèrement éméché, s’avança avec un sourire goguenard.
« Bah, pas plus compliqué que la cuisine ou le garde-vin des casernes, » lança-t-il avant d’opérer avec une précision déconcertante. Le cliquetis libérateur retentit à peine une seconde plus tard, et la porte céda.
Nous pénétrâmes en hâte dans la demeure, refermant derrière nous avec une rapidité dictée par la peur d’être surpris. L’odeur stagnante du lieu, un mélange rance de substances médicinales et de quelque chose de plus insidieux, s’insinua immédiatement dans nos narines. Instinctivement, les rôles s’établirent. Renault, Dupois et Babin entreprirent une fouille méthodique du rez-de-chaussée, tandis que mon intuition me guida vers l’étage, persuadé que c’était là que Rigaut cachait ses secrets les plus inavouables.
Dans l’obscurité tremblante de ma chandelle, je longeai un couloir austère et silencieux. Une porte verrouillée me fit aussitôt frémir d’un mélange d’excitation et d’appréhension. En bas, les voix étouffées de mes compagnons résonnaient faiblement, accompagnées par le bruit de leurs découvertes. Renault fut le premier à tomber sur un objet d’épouvante : un cercueil scellé abritant un cadavre décapité, une tête posée à côté, grotesque et étrangère au corps auquel elle n’appartenait manifestement pas. Babin, quant à lui, dénicha un coffre contenant des masques de jute identiques à ceux que nous avions aperçus sur les morts recomposés la veille. Le malaise qui nous oppressait tous grandissait comme une ombre vivante.
Ne pouvant ouvrir seul la porte du couloir, j’appelai Dupois à la rescousse. Mais même ses talents ne suffirent pas face à ce verrou obstiné. Résolu à ne pas renoncer, je fis signe à Babin, qui s’avança avec son pied-de-biche, le visage fermé et déterminé. La porte céda dans un craquement sinistre, dévoilant une pièce plongée dans une pénombre oppressante.
À la lueur vacillante de nos chandelles, une vision d’effroi nous saisit. Un corps entièrement écorché, dépouillé de sa peau, se dressait dans une immobilité dérangeante. L’illusion d’un mouvement naquit du jeu des ombres et de nos esprits surmenés. Mon souffle se bloqua, et dans un éclair d’intuition glaçante, l’image du « pape sanglant » entrevu dans le domaine de Fénalik surgit dans mon esprit. Le lien entre Rigaut et ce sinistre personnage s’imposait désormais comme une certitude.
À proximité, un bureau attira notre attention. Sur sa surface trônait un livre de comptes macabre, répertoriant avec une précision obsessionnelle les noms et chiffres des exécutés : plus de 9 900 déjà. Une sueur froide parcourut mon échine alors que je comprenais que la goule avait raison : le sinistre « compte des 10 000 » avançait inexorablement. Mes mains tremblaient lorsque je découvris enfin, dissimulé dans un compartiment, le mystérieux livre noir à la reliure de laiton. Je résistai à la tentation de l’ouvrir, me contentant de le glisser précipitamment dans ma redingote, sachant que ce qu’il contenait dépassait l’entendement.
Pendant ce temps, Renault et Dupois découvrirent un coffre caché derrière une affiche révolutionnaire. Après une habile manipulation, Dupois mit à jour des rouleaux de cuir en latin, rappelant sinistrement ceux trouvés chez Fénalik. Sans hésitation, nous les emportâmes, conscients que ces documents recélaient probablement des secrets que nous ne pouvions encore concevoir.
Babin, poussé par une colère froide et méthodique, entreprit alors une tâche macabre : détruire par le feu les preuves de la folie de Rigaut. Livres de comptes, masques de jute, corps mutilés, tout fut jeté dans l’âtre, nourrissant un brasier aux flammes dansantes. Ce fut un spectacle aussi troublant que cathartique. Alors que les restes calcinés s’effondraient en cendres, un semblant de soulagement s’installa, bien que mêlé d’un doute persistant : cela suffirait-il à ralentir Rigaut ? Je n’en étais pas convaincu.

Nous quittâmes la demeure avec notre butin maudit, errant dans les ténèbres comme des voleurs d’âmes. Babin, pragmatique, nous conduisit chez lui pour nous abriter, tandis que Dupois, toujours intrépide, fit un détour risqué par la caserne pour récupérer son chien fidèle.
La chandelle mourait doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs rugueux de la pièce. Le sommeil, bien qu’insuffisant, m’avait offert un répit passager. Cependant, dès que mes yeux s’ouvrirent, une pensée obsédante se fraya un chemin dans mon esprit : le livre. La reliure de laiton, marquée par le poids des siècles, semblait me murmurer silencieusement dans la pénombre. Mon esprit rationnel luttait encore, mais la curiosité dévorante avait déjà gagné.
J’entrouvris l’ouvrage avec une lenteur presque cérémonieuse. Un souffle glacial traversa la pièce, bien que les fenêtres fussent hermétiquement closes. La première page, ornée d’arabesques incompréhensibles, m’attira d’une manière viscérale. En avançant dans ses pages, une illustration d’une clarté dérangeante se révéla. Un sacrifice humain sous un ciel nocturne étoilé, les astres formant des spirales impossibles. Le dessin, d’une minutie presque surnaturelle, semblait s’animer sous mon regard. Les étoiles tourbillonnaient, hypnotiques, tandis qu’un point central invisible absorbait tout, m’entraînant dans son abîme.
Mon esprit se déroba. Je tentai de fermer l’ouvrage, mais mes mains, comme possédées, continuaient de tourner les pages. L’encre semblait vivante, rampante, transformant le papier en une mer mouvante et insondable. Un vertige me saisit lorsque je me surpris à incliner le livre, suivant machinalement le mouvement infernal des lignes. Une voix sourde, lointaine, résonna dans les confins de ma conscience, murmurant des fragments de latin. Et alors, dans un éclat de révélation terrifiant, je lus.

Les mots déferlèrent dans mon esprit, une marée noire et irrésistible. Je ne parlais pas le latin, du moins le croyais-je. Mais le livre lui-même semblait insuffler en moi une compréhension instinctive. Les phrases s’imprimaient dans mon cerveau avec une netteté insupportable, chaque mot gravant une cicatrice profonde dans ma raison. Une page décrivait un rituel : une mélodie jouée sur un instrument inconnu, accompagnée d’un sacrifice scellé par un symbole effroyable. La musique… le Vide Suprême…
Tout s’imbriquait dans un puzzle d’horreurs indicibles. Les secrets que je déterrais n’étaient pas faits pour l’humanité. Un désespoir écrasant m’assaillit, suivi d’une paranoïa glaçante. Mes compagnons, dans l’ombre, murmuraient sûrement à Rigaut. Leurs visages, d’abord familiers, prirent des contours grotesques dans ma perception altérée. Ils complotaient contre moi, j’en étais certain. Je devais fuir.
La panique me fit bondir, et je reculai maladroitement vers la porte. Renault s’avança, l’air inquiet, mais son regard semblait accusateur. Je ne pouvais pas lui faire confiance. Babin, toujours solide, me murmura des mots que je ne pus entendre, leurs syllabes se tordant en accusations dans mon esprit fiévreux. D’un geste brusque, je me jetai vers l’escalier.
Dans ma fuite, mes pieds se dérobèrent. Je chutai lourdement, une douleur fulgurante m’arrachant à mon délire. Avant que je puisse me relever, Babin se précipita sur moi, m’enserrant de ses bras robustes. Renault était à ses côtés, tentant de m’apaiser. Peu à peu, le brouillard s’éclaircit. Ce n’était pas la folie de mes compagnons, mais la mienne, qui avait failli me conduire à la perdition.
Allongé sur le sol, respirant difficilement, je sentis un fragment de lucidité revenir. Mais ce que j’avais lu dans ce livre restait gravé dans ma mémoire, un poison dont je ne pourrais jamais me défaire. En le survolant à peine, j’avais entrevu la musique de l’au-delà, un vide si ancien et si vaste qu’il faisait paraître Satan insignifiant.
Le livre avait un nom, gravé dans ma conscience comme un fer rouge : le Vide Suprême. Les fragments que j’avais assimilés dévoilaient un rituel terrifiant : une musique, porte d’un autre monde, devait être entendue par un individu, dont le sacrifice rituel, scellé par le médaillon maudit de Rigaut, en détournerait la puissance. Cette guillotine infâme, gravée du sceau arraché aux tréfonds des enfers, déroberait l’âme du sacrifié pour briser le rituel. Mais pour cela, il faudrait qu’une personne entende cette musique impie. Si personne ne l’avait encore perçue, il faudrait trouver un musicien capable de la jouer, condamnant ainsi une victime à l’entendre et à mourir pour notre salut. Une vérité s’imposa à moi, cruelle et inexorable : le sang d’un innocent serait versé.




